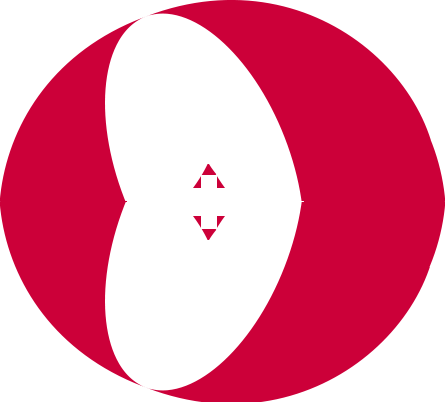| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo 6 volumes C. Lévy, 1889. CINQUIÈME VOLUME |
|
VIII LE VOYAGE. Monte-Cristo poussa un cri de joie en voyant les deux jeunes gens ensemble. — Ah ! ah ! dit-il. Eh bien, j’espère que tout est fini, éclairci, arrangé ? — Oui, dit Beauchamp, des bruits absurdes qui sont tombés d’eux-mêmes, et qui maintenant, s’ils se renouvelaient, m’auraient pour premier antagoniste. Ainsi donc, ne parlons plus de cela. — Albert vous dira, reprit le comte, que c’est le conseil que je lui avais donné. Tenez, ajouta-t-il, vous me voyez au reste achevant la plus exécrable matinée que j’aie jamais passée, je crois. — Que faites-vous ? dit Albert, vous mettez de l’ordre dans vos papiers, ce me semble ? — Dans mes papiers, Dieu merci non ! il y a toujours dans mes papiers un ordre merveilleux, attendu que je n’ai pas de papiers, mais dans les papiers de M. Cavalcanti. — De M. Cavalcanti ? demanda Beauchamp. — Eh oui ! ne savez-vous pas que c’est un jeune homme que lance le comte ? dit Morcerf. — Non pas, entendons-nous bien, répondit Monte-Cristo, je ne lance personne, et M. Cavalcanti moins que tout autre. — Et qui va épouser mademoiselle Danglars en mon lieu et place ; ce qui, continua Albert en essayant de sourire, comme vous pouvez bien vous en douter, mon cher Beauchamp, m’affecte cruellement. — Comment ! Cavalcanti épouse mademoiselle Danglars ? demanda Beauchamp. — Ah çà ! mais vous venez donc du bout du monde ? dit Monte-Cristo ; vous, un journaliste, le mari de la Renommée ! Tout Paris ne parle que de cela. — Et c’est vous, comte, qui avez fait ce mariage ? demanda Beauchamp. — Moi ? Oh ! silence, monsieur le nouvelliste, n’allez pas dire de pareilles choses ! Moi, bon Dieu ! faire un mariage ? Non, vous ne me connaissez pas ; je m’y suis au contraire opposé de tout mon pouvoir, j’ai refusé de faire la demande. — Ah ! je comprends dit Beauchamp : à cause de notre ami Albert ? — À cause de moi, dit le jeune homme ; oh ! non, par ma foi ! Le comte me rendra la justice d’attester que je l’ai toujours prié, au contraire, de rompre ce projet, qui heureusement est rompu. Le comte prétend que ce n’est pas lui que je dois remercier ; soit, j’élèverai, comme les anciens, un autel Deo ignoto. — Écoutez, dit Monte-Cristo, c’est si peu moi, que je suis en froid avec le beau-père et avec le jeune homme ; il n’y a que mademoiselle Eugénie, laquelle ne me paraît pas avoir une profonde vocation pour le mariage, qui, en voyant à quel point j’étais peu disposé à la faire renoncer à sa chère liberté, m’ait conservé son affection. — Et vous dites que ce mariage est sur le point de se faire ? — Oh ! mon Dieu ! oui, malgré tout ce que j’ai pu dire. Moi, je ne connais pas le jeune homme, on le prétend riche et de bonne famille, mais pour moi ces choses sont de simples on dit. J’ai répété tout cela à satiété à M. Danglars, mais il est entiché de son Lucquois. J’ai été jusqu’à lui faire part d’une circonstance qui, pour moi, était plus grave : le jeune homme a été changé en nourrice, enlevé par des Bohémiens ou égaré par son précepteur, je ne sais pas trop. Mais ce que je sais, c’est que son père l’a perdu de vue depuis plus de dix années ; ce qu’il a fait pendant ces dix années de vie errante, Dieu seul le sait. Eh bien ! rien de tout cela n’y a fait. On m’a chargé d’écrire au major, de lui demander des papiers ; ces papiers, les voilà. Je les leur envoie, mais, comme Pilate, en me lavant les mains. — Et mademoiselle d’Armilly, demanda Beauchamp, quelle mine vous fait-elle à vous, qui lui enlevez son élève ? — Dame ! je ne sais pas trop : mais il paraît qu’elle part pour l’Italie. Madame Danglars m’a parlé d’elle et m’a demandé des lettres de recommandation pour les impresarii ; je lui ai donné un mot pour le directeur du théâtre Valle, qui m’a quelques obligations. Mais qu’avez-vous donc, Albert ? vous avez l’air tout attristé ; est-ce que, sans vous en douter, vous êtes amoureux de mademoiselle Danglars, par exemple ? — Pas que je sache, dit Albert en souriant tristement. Beauchamp se mit à regarder les tableaux. — Mais enfin, continua Monte-Cristo, vous n’êtes pas dans votre état ordinaire. Voyons, qu’avez-vous, dites ? — J’ai la migraine, dit Albert. — Eh bien ! mon cher vicomte, dit Monte-Cristo, j’ai en ce cas un remède infaillible à vous proposer ; remède qui m’a réussi à moi chaque fois que j’ai éprouvé quelque contrariété. — Lequel ? demanda le jeune homme. — Le déplacement. — En vérité ? dit Albert. — Oui ; et tenez, comme en ce moment-ci je suis excessivement contrarié, je me déplace. Voulez-vous que nous nous déplacions ensemble ? — Vous, contrarié, comte ! dit Beauchamp ; et de quoi donc ? — Pardieu ! vous en parlez fort à votre aise, vous ; je voudrais bien vous voir avec une instruction se poursuivant dans votre maison ! — Une instruction ! quelle instruction ? — Eh ! celle que M. de Villefort dresse contre mon aimable assassin donc, une espèce de brigand échappé du bagne, à ce qu’il paraît. — Ah ! c’est vrai, dit Beauchamp, j’ai lu le fait dans les journaux. Qu’est-ce que c’est que ce Caderousse ? — Eh bien… mais il paraît que c’est un Provençal. M. de Villefort en a entendu parler quand il était à Marseille, et M. Danglars se rappelle l’avoir vu. Il en résulte que M. le procureur du roi prend l’affaire fort à cœur, qu’elle a, à ce qu’il paraît, intéressé au plus haut degré le préfet de police, et que, grâce à cet intérêt dont je suis on ne peut plus reconnaissant, on m’envoie ici depuis quinze jours tous les bandits qu’on peut se procurer dans Paris et dans la banlieue, sous prétexte que ce sont les assassins de M. Caderousse ; d’où il résulte que, dans trois mois, si cela continue, il n’y aura pas un voleur ni un assassin dans ce beau royaume de France qui ne connaisse le plan de ma maison sur le bout de son doigt ; aussi je prends le parti de la leur abandonner tout entière, et de m’en aller aussi loin que la terre pourra me porter. Venez avec moi, vicomte, je vous emmène. — Volontiers. — Alors, c’est convenu ? — Oui, mais où cela ? — Je vous l’ai dit, où l’air est pur, où le bruit endort où, si orgueilleux que l’on soit, on se sent humble et l’on se trouve petit. J’aime cet abaissement, moi, que l’on dit maître de l’univers comme Auguste. — Où allez-vous, enfin ? — À la mer, vicomte, à la mer. Je suis un marin, voyez-vous ; tout enfant, j’ai été bercé dans les bras du vieil Océan et sur le sein de la belle Amphitrite ; j’ai joué avec le manteau vert de l’un et la robe azurée de l’autre ; j’aime la mer comme on aime une maîtresse, et quand il y a longtemps que je ne l’ai vue, je m’ennuie d’elle. — Allons, comte, allons ! — À la mer. — Oui. — Vous acceptez ? — J’accepte. — Eh bien, vicomte, il y aura ce soir dans ma cour un briska de voyage, dans lequel on peut s’étendre comme dans son lit ; ce briska sera attelé de quatre chevaux de poste. Monsieur Beauchamp, on y tient quatre très facilement. Voulez-vous venir avec nous ? je vous emmène ! — Merci, je viens de la mer. — Comment ! vous venez de la mer ? — Oui, ou à peu près. Je viens de faire un petit voyage aux îles Borromées. — Qu’importe ! venez toujours, dit Albert. — Non, cher Morcerf, vous devez comprendre que du moment où je refuse, c’est que la chose est impossible. D’ailleurs, il est important, ajouta-t-il en baissant la voix, que je reste à Paris, ne fût-ce que pour surveiller la boîte du journal. — Ah ! vous êtes un bon et excellent ami, dit Albert ; oui, vous avez raison, veillez, surveillez, Beauchamp, et tâchez de découvrir l’ennemi à qui cette révélation a dû le jour. Albert et Beauchamp se séparèrent : leur dernière poignée de main renfermait tout le sens que leurs lèvres ne pouvaient exprimer devant un étranger. — Excellent garçon que Beauchamp ! dit Monte-Cristo après le départ du journaliste ; n’est-ce pas, Albert ? — Oh ! oui, un homme de cœur, je vous en réponds ; aussi je l’aime de toute mon âme. Mais, maintenant que nous voilà seuls, quoique la chose me soit à peu près égale, où allons-nous ? — En Normandie, si vous voulez bien. — À merveille. Nous sommes tout à fait à la campagne, n’est-ce pas ? point de société, point de voisins ? — Nous sommes tête à tête avec des chevaux pour courir, des chiens pour chasser, et une barque pour pêcher, voilà tout. — C’est ce qu’il me faut ; je préviens ma mère, et je suis à vos ordres. — Mais, dit Monte-Cristo, vous permettra-t-on ? — Quoi ? — De venir en Normandie. — À moi ? est-ce que je ne suis pas libre ? — D’aller où vous voulez, seul, je le sais bien, puisque je vous ai rencontré échappé par l’Italie. — Eh bien ? — Mais de venir avec l’homme qu’on appelle le comte de Monte-Cristo ? — Vous avez peu de mémoire, comte. — Comment cela ? — Ne vous ai-je pas dit toute la sympathie que ma mère avait pour vous ? — Souvent femme varie, a dit François Ier ; la femme c’est l’onde, a dit Shakespeare : l’un était un grand roi et l’autre un grand poète, et chacun d’eux devait connaître la femme. — Oui, la femme ; mais ma mère n’est point la femme, c’est une femme. — Permettrez-vous à un pauvre étranger de ne point comprendre parfaitement toutes les subtilités de votre langue ? — Je veux dire que ma mère est avare de ses sentiments, mais qu’une fois qu’elle les a accordés, c’est pour toujours. — Ah ! vraiment, dit en soupirant Monte-Cristo ; et vous croyez qu’elle me fait l’honneur de m’accorder un sentiment autre que la plus parfaite indifférence ? — Écoutez ! je vous l’ai déjà dit et je vous le répète, reprit Morcerf, il faut que vous soyez réellement un homme bien étrange et bien supérieur. — Oh ! — Oui, car ma mère s’est laissé prendre, je ne dirai pas à la curiosité, mais à l’intérêt que vous inspirez. Quand nous sommes seuls, nous ne causons que de vous. — Et elle vous dit de vous méfier de ce Manfred ? — Au contraire, elle me dit : « Morcerf, je crois le comte une noble nature ; tâche de te faire aimer de lui. » Monte-Cristo détourna les yeux et poussa un soupir. — Ah ! vraiment ? dit-il. — De sorte, vous comprenez, continua Albert, qu’au lieu de s’opposer à mon voyage, elle l’approuvera de tout son cœur, puisqu’il rentre dans les recommandations qu’elle me fait chaque jour. — Allez donc, dit Monte-Cristo ; à ce soir. Soyez ici à cinq heures ; nous arriverons là-bas à minuit ou une heure. — Comment ! au Tréport ? … — Au Tréport ou dans les environs. — Il ne vous faut que huit heures pour faire quarante-huit lieues ? — C’est encore beaucoup, dit Monte-Cristo. — Décidément vous êtes l’homme des prodiges, et vous arriverez non seulement à dépasser les chemins de fer, ce qui n’est pas bien difficile, en France surtout, mais encore à aller plus vite que le télégraphe. — En attendant, vicomte, comme il nous faut toujours sept ou huit heures pour arriver là-bas, soyez exact. — Soyez tranquille, je n’ai rien autre chose à faire d’ici là que de m’apprêter. — À cinq heures, alors. — À cinq heures. Albert sortit. Monte-Cristo, après lui avoir en souriant fait un signe de la tête, demeura un instant pensif et comme absorbé dans une profonde méditation. Enfin, passant la main sur son front, comme pour écarter sa rêverie, il alla au timbre et frappa deux coups. Au bruit des deux coups frappés par Monte-Cristo sur le timbre, Bertuccio entra. — Maître Bertuccio, dit-il, ce n’est pas demain, ce n’est pas après-demain, comme je l’avais pensé d’abord, c’est ce soir que je pars pour la Normandie ; d’ici à cinq heures, c’est plus de temps qu’il ne vous en faut ; vous ferez prévenir les palefreniers du premier relais ; M. de Morcerf m’accompagne. Allez. Bertuccio obéit, et un piqueur courut à Pontoise annoncer que la chaise de poste passerait à six heures précises. Le palefrenier de Pontoise envoya au relais suivant un exprès, qui en envoya un autre ; et, six heures après, tous les relais disposés sur la route étaient prévenus. Avant de partir, le comte monta chez Haydée, lui annonça son départ, lui dit le lieu où il allait, et mit toute sa maison à ses ordres. Albert fut exact. Le voyage, sombre à son commencement, s’éclaircit bientôt par l’effet physique de la rapidité. Morcerf n’avait pas idée d’une pareille vitesse. — En effet, dit Monte-Cristo, avec votre poste faisant ses deux lieues à l’heure, avec cette loi stupide qui défend à un voyageur de dépasser l’autre sans lui demander la permission, et qui fait qu’un voyageur malade ou quinteux a le droit d’enchaîner à sa suite les voyageurs allègres et bien portants, il n’y a pas de locomotion possible ; moi j’évite cet inconvénient en voyageant avec mon propre postillon et mes propres chevaux, n’est-ce pas, Ali ? Et le comte, passant la tête par la portière, poussait un petit cri d’excitation qui donnait des ailes aux chevaux ; ils ne couraient plus, ils volaient. La voiture roulait comme un tonnerre sur ce pavé royal, et chacun se détournait pour voir passer ce météore flamboyant. Ali, répétant ce cri, souriait montrant ses dents blanches, serrant dans ses mains robustes les rênes écumantes, aiguillonnant les chevaux, dont les belles crinières s’éparpillaient au vent ; Ali, l’enfant du désert, se retrouvait dans son élément, et avec son visage noir, ses yeux ardents, son burnous de neige, il semblait, au milieu de la poussière qu’il soulevait, le génie du simoun et le dieu de l’ouragan. — Voilà, dit Morcerf, une volupté que je ne connaissais pas, c’est la volupté de la vitesse. Et les derniers nuages de son front se dissipaient, comme si l’air qu’il fendait emportait ces nuages avec lui. — Mais où diable trouvez-vous de pareils chevaux ? demanda Albert. Vous les faites donc faire exprès ? (cont.) |
|
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo Tome 5 |