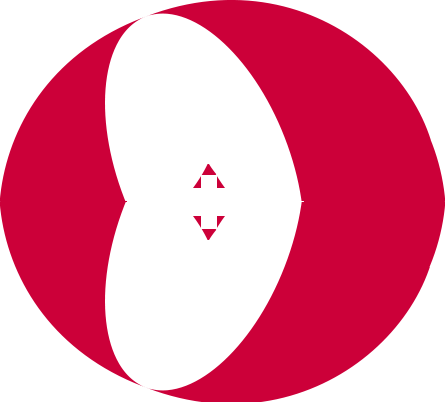| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
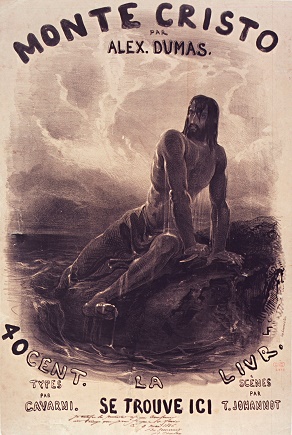 |
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo 6 volumes C. Lévy, 1889. TROISIÈME VOLUME |
|
XIV TOXICOLOGIE. (cont.) — Que voulez-vous ! monsieur, dit en riant la jeune femme, on fait ce qu’on peut. Tout le monde n’a pas le secret des Médicis ou des Borgia. — Maintenant, dit le comte en haussant les épaules, voulez-vous que je vous dise ce qui cause toutes ces inepties ? C’est que sur vos théâtres, à ce dont j’ai pu juger du moins en lisant les pièces qu’on y joue, on voit toujours des gens avaler le contenu d’une fiole ou mordre le chaton d’une bague et tomber raides morts : cinq minutes après, le rideau baisse ; les spectateurs sont dispersés. On ignore les suites du meurtre ; on ne voit jamais ni le commissaire de police avec son écharpe, ni le caporal avec ses quatre hommes, et cela autorise beaucoup de pauvres cerveaux à croire que les choses se passent ainsi. Mais sortez un peu de France, allez soit à Alep soit au Caire, soit seulement à Naples et à Rome, et vous verrez passer par la rue des gens droits, frais et roses dont le Diable boiteux, s’il vous effleurait de son manteau, pourrait vous dire : « Ce monsieur est empoisonné depuis trois semaines, et il sera tout à fait mort dans un mois. » — Mais alors, dit madame de Villefort, ils ont donc retrouvé le secret de cette fameuse aqua-tofana que l’on me disait perdu à Pérouse. — Eh, mon Dieu ! madame, est-ce que quelque chose se perd chez les hommes ! Les arts se déplacent et font le tour du monde ; les choses changent de nom ; voilà tout, et le vulgaire s’y trompe ; mais c’est toujours le même résultat ; le poison porte particulièrement sur tel ou tel organe ; l’un sur l’estomac, l’autre sur le cerveau, l’autre sur les intestins. Eh bien ! le poison détermine une toux, cette toux une fluxion de poitrine ou telle autre maladie cataloguée au livre de la science, ce qui ne l’empêche pas d’être parfaitement mortelle, et qui, ne le fût-elle pas, le deviendrait grâce aux remèdes que lui administrent les naïfs médecins, en général fort mauvais chimistes, et qui tourneront pour ou contre la maladie, comme il vous plaira ; et voilà un homme tué avec art et dans toutes les règles, sur lequel la justice n’a rien à apprendre, comme disait un horrible chimiste de mes amis, l’excellent abbé Adelmonte de Taormine, en Sicile, lequel avait fort étudié ces phénomènes nationaux. — C’est effrayant, mais c’est admirable, dit la jeune femme immobile d’attention ; je croyais, je l’avoue, toutes ces histoires des inventions du moyen âge. — Oui, sans doute, mais qui se sont encore perfectionnées de nos jours. À quoi donc voulez-vous que servent le temps, les encouragements, les médailles, les croix, les prix Montyon, si ce n’est pour mener la société vers sa plus grande perfection ? Or, l’homme ne sera parfait que lorsqu’il saura créer et détruire comme Dieu ; il sait déjà détruire, c’est la moitié du chemin de fait. — De sorte, reprit madame de Villefort revenant invariablement à son but, que les poisons des Borgia, des Médicis, des René, des Ruggieri, et plus tard probablement du baron de Trenk, dont ont tant abusé le drame moderne et le roman… — Étaient des objets d’art, madame, pas autre chose, répondit le comte. Croyez-vous que le vrai savant s’adresse banalement à l’individu même ? Non pas. La science aime les ricochets, les tours de force, la fantaisie, si l’on peut dire cela. Ainsi, par exemple, cet excellent abbé Adelmonte, dont je vous parlais tout à l’heure, avait fait, sous ce rapport, des expériences étonnantes. — Vraiment ! — Oui, je vous en citerai une seule. Il avait un fort beau jardin plein de légumes, de fleurs et de fruits ; parmi ces légumes, il choisissait le plus honnête de tous, un chou, par exemple. Pendant trois jours il arrosait ce chou avec une dissolution d’arsenic ; le troisième jour, le chou tombait malade et jaunissait, c’était le moment de le couper ; pour tous il paraissait mûr et conservait son apparence honnête : pour l’abbé Adelmonte seul il était empoisonné. Alors, il apportait le chou chez lui, prenait un lapin, l’abbé Adelmonte avait une collection de lapins, de chats et de cochons d’Inde qui ne le cédait en rien à sa collection de légumes, de fleurs et de fruits : l’abbé Adelmonte prenait donc un lapin et lui faisait manger une feuille de chou, le lapin mourait. Quel est le juge d’instruction qui oserait trouver à redire à cela, et quel est le procureur du roi qui s’est jamais avisé de dresser contre M. Magendie ou M. Flourens un réquisitoire à propos des lapins, des cochons d’Inde et des chats qu’ils ont tués ? Aucun. Voilà donc le lapin mort sans que la justice s’en inquiète. Ce lapin mort, l’abbé Adelmonte le fait vider par sa cuisinière et jette les intestins sur un fumier. Sur ce fumier, il y a une poule, elle becquète ces intestins, tombe malade à son tour et meurt le lendemain. Au moment où elle se débat dans les convulsions de l’agonie, un vautour passe (il y a beaucoup de vautours dans le pays d’Adelmonte), celui-là fond sur le cadavre, l’emporte sur un rocher et en dîne. Trois jours après, le pauvre vautour, qui, depuis ce repas, s’est trouvé constamment indisposé, se sent pris d’un étourdissement au plus haut de la nue ; il roule dans le vide et vient tomber lourdement dans votre vivier ; le brochet, l’anguille et la murène mangent goulûment, vous savez cela, ils mordent le vautour. Eh bien, supposez que le lendemain l’on serve sur votre table cette anguille, ce brochet ou cette murène, empoisonnés à la quatrième génération, votre convive, lui, sera empoisonné à la cinquième et mourra au bout de huit ou dix jours de douleurs d’entrailles, de maux de cœur, d’abcès au pylore. On fera l’autopsie, et les médecins diront : « Le sujet est mort d’une tumeur au foie ou d’une fièvre typhoïde. » — Mais, dit madame de Villefort, toutes ces circonstances, que vous enchaînez les unes aux autres, peuvent être rompues par le moindre accident ; le vautour peut ne pas passer à temps ou tomber à cent pas du vivier. — Ah ! voilà justement où est l’art : pour être un grand chimiste en Orient, il faut diriger le hasard ; on y arrive. Madame de Villefort était rêveuse et écoutait. — Mais, dit-elle, l’arsenic est indélébile ; de quelque façon qu’on l’absorbe, il se retrouvera dans le corps de l’homme, du moment où il sera entré en quantité suffisante pour donner la mort. — Bien ! s’écria Monte-Cristo, bien ! voilà justement ce que je dis à ce bon Adelmonte. Il réfléchit, sourit, et me répondit par un proverbe sicilien, qui est aussi, je crois, un proverbe français : « Mon enfant, le monde n’a pas été fait en un jour, mais en sept ; revenez dimanche. » Le dimanche suivant, je revins ; au lieu d’avoir arrosé son chou avec de l’arsenic, il l’avait arrosé avec une dissolution de sel à base de strychnine, strychnos colubrina, comme disent les savants. Cette fois le chou n’avait pas l’air malade le moins du monde ; aussi le lapin ne s’en défia-t-il point ; aussi cinq minutes après le lapin était-il mort ; la poule mangea le lapin, et le lendemain elle était trépassée. Alors nous fîmes les vautours, nous emportâmes la poule et nous l’ouvrîmes. Cette fois tous les symptômes particuliers avaient disparu, et il ne restait que les symptômes généraux. Aucune indication particulière dans aucun organe ; exaspération du système nerveux, voilà tout, et trace de congestion cérébrale, pas davantage ; la poule n’avait pas été empoisonnée, elle était morte d’apoplexie. C’est un cas rare chez les poules, je le sais bien, mais fort commun chez les hommes. Madame de Villefort paraissait de plus en plus rêveuse. — C’est bien heureux, dit-elle, que de pareilles substances ne puissent être préparées que par des chimistes, car, en vérité, la moitié du monde empoisonnerait l’autre. — Par des chimistes ou des personnes qui s’occupent de chimie, répondit négligemment Monte-Cristo. — Et puis, dit madame de Villefort s’arrachant elle-même et avec effort à ses pensées, si savamment préparé qu’il soit, le crime est toujours le crime : et s’il échappe à l’investigation humaine, il n’échappe pas au regard de Dieu. Les Orientaux sont plus forts que nous sur les cas de conscience, et ont prudemment supprimé l’enfer ; voilà tout. — Eh ! madame, ceci est un scrupule qui doit naturellement naître dans une âme honnête comme la vôtre, mais qui en serait bientôt déraciné par le raisonnement. Le mauvais côté de la pensée humaine sera toujours résumé par ce paradoxe de Jean Jacques Rousseau, vous savez : « Le mandarin qu’on tue à cinq mille lieues en levant le bout du doigt. » La vie de l’homme se passe à faire de ces choses-là, et son intelligence s’épuise à les rêver. Vous trouvez fort peu de gens qui s’en aillent brutalement planter un couteau dans le cœur de leur semblable ou qui administrent, pour le faire disparaître de la surface du globe, cette quantité d’arsenic que nous disions tout à l’heure. C’est là réellement une excentricité ou une bêtise. Pour en arriver là, il faut que le sang se chauffe à trente-six degrés, que le pouls batte à quatre-vingt-dix pulsations, et que l’âme sorte de ses limites ordinaires ; mais si, passant, comme cela se pratique en philologie, du mot au synonyme mitigé, vous faites une simple élimination ; au lieu de commettre un ignoble assassinat, si vous écartez purement et simplement de votre chemin celui qui vous gêne, et cela sans choc, sans violence, sans l’appareil de ces souffrances, qui, devenant un supplice, font de la victime un martyr, et de celui qui agit un carnifex dans toute la force du mot ; s’il n’y a ni sang, ni hurlements, ni contorsions, ni surtout cette horrible et compromettante instantanéité de l’accomplissement, alors vous échappez au coup de la loi humaine qui vous dit : Ne trouble pas la société ! Voilà comment procèdent et réussissent les gens d’Orient, personnages graves et flegmatiques, qui s’inquiètent peu des questions de temps dans les conjonctures d’une certaine importance. — Il reste la conscience, dit madame de Villefort d’une voix émue et avec un soupir étouffé. — Oui, dit Monte-Cristo, oui, heureusement, il reste la conscience, sans quoi l’on serait fort malheureux. Après toute action un peu vigoureuse, c’est la conscience qui nous sauve, car elle nous fournit mille bonnes excuses dont seuls nous sommes juges ; et ces raisons, si excellentes qu’elles soient pour nous conserver le sommeil, seraient peut-être médiocres devant un tribunal pour nous conserver la vie. Ainsi Richard III, par exemple, a dû être merveilleusement servi par la conscience après la suppression des deux enfants d’Édouard IV ; en effet, il pouvait se dire : Ces deux enfants d’un roi cruel et persécuteur, et qui avaient hérité des vices de leur père, que moi seul ai su reconnaître dans leurs inclinations juvéniles ; ces deux enfants me gênaient pour faire la félicité du peuple anglais, dont ils eussent infailliblement fait le malheur. Ainsi fut servie par sa conscience Lady Macbeth, qui voulait, quoi qu’en ait dit Shakespeare, donner un trône, non à son mari, mais à son fils. Ah ! l’amour maternel est une si grande vertu, un si puissant mobile, qu’il fait excuser bien des choses ; aussi, après la mort de Duncan, Lady Macbeth eût-elle été fort malheureuse sans sa conscience. Madame de Villefort absorbait avec avidité ces effrayantes maximes et ces horribles paradoxes débités par le comte avec cette naïve ironie qui lui était particulière. Puis après un instant de silence : — Savez-vous, dit-elle, monsieur le comte, que vous êtes un terrible argumentateur, et que vous voyez le monde sous un jour quelque peu livide ! Est-ce donc en regardant l’humanité à travers les alambics et les cornues que vous l’avez jugée telle ? Car vous aviez raison, vous êtes un grand chimiste, et cet élixir que vous avez fait prendre à mon fils, et qui l’a si rapidement rappelé à la vie… — Oh ! ne vous y fiez pas, madame, dit Monte-Cristo, une goutte de cet élixir a suffi pour rappeler à la vie cet enfant qui se mourait, mais trois gouttes eussent poussé le sang à ses poumons de manière à lui donner des battements de cœur ; six lui eussent coupé la respiration, et causé une syncope beaucoup plus grave que celle dans laquelle il se trouvait ; dix enfin l’eussent foudroyé. Vous savez, madame, comme je l’ai écarté vivement de ces flacons auxquels il avait l’imprudence de toucher ? — C’est donc un poison terrible ? — Oh ! mon Dieu, non ! D’abord, admettons ceci, que le mot poison n’existe pas, puisqu’on se sert en médecine des poisons les plus violents, qui deviennent, par la façon dont ils sont administrés, des remèdes salutaires. — Qu’était-ce donc alors ? — C’était une savante préparation de mon ami, cet excellent abbé Adelmonte, et dont il m’a appris à me servir. — Oh ! dit madame de Villefort, ce doit être un excellent antispasmodique. — Souverain, madame, vous l’avez vu, répondit le comte, et j’en fais un usage fréquent, avec toute la prudence possible, bien entendu, ajouta-t-il en riant. — Je le crois, répliqua sur le même ton madame de Villefort. Quant à moi, si nerveuse et si prompte à m’évanouir, j’aurais besoin d’un docteur Adelmonte pour m’inventer des moyens de respirer librement et me tranquilliser sur la crainte que j’éprouve de mourir un beau jour suffoquée. En attendant, comme la chose est difficile à trouver en France, et que votre abbé n’est probablement pas disposé à faire pour moi le voyage de Paris, je m’en tiens aux antispasmodiques de M. Planche ; et la menthe et les gouttes d’Hoffmann jouent chez moi un grand rôle. Tenez, voici des pastilles que je me fais faire exprès ; elles sont à double dose. Monte-Cristo ouvrit la boîte d’écaille que lui présentait la jeune femme, et respira l’odeur des pastilles en amateur digne d’apprécier cette préparation. — Elles sont exquises, dit-il, mais soumises à la nécessité de la déglutition, fonction qui souvent est impossible à accomplir de la part de la personne évanouie. J’aime mieux mon spécifique. — Mais, bien certainement, moi aussi, je le préférerais d’après les effets que j’en ai vus surtout ; mais c’est un secret sans doute, et je ne suis pas assez indiscrète pour vous le demander. — Mais moi, madame, dit Monte-Cristo en se levant, je suis assez galant pour vous l’offrir. — Oh ! monsieur. — Seulement rappelez-vous une chose : c’est qu’à petite dose c’est un remède, à forte dose c’est un poison. Une goutte rend la vie, comme vous l’avez vu ; cinq ou six tueraient infailliblement, et d’une façon d’autant plus terrible, qu’étendues dans un verre de vin elles n’en changeraient aucunement le goût. Mais je m’arrête, madame, j’aurais presque l’air de vous conseiller. Six heures et demie venaient de sonner, on annonça une amie de madame de Villefort, qui venait dîner avec elle. — Si j’avais l’honneur de vous voir pour la troisième ou quatrième fois, monsieur le comte, au lieu de vous voir pour la seconde, dit madame de Villefort ; si j’avais l’honneur d’être votre amie, au lieu d’avoir tout bonnement le bonheur d’être votre obligée, j’insisterais pour vous retenir à dîner, et je ne me laisserais pas battre par un premier refus. — Mille grâces, madame, répondit Monte-Cristo, j’ai moi même un engagement auquel je ne puis manquer. J’ai promis de conduire au spectacle une princesse grecque de mes amies, qui n’a pas encore vu le Grand Opéra, et qui compte sur moi pour l’y mener. — Allez, monsieur, mais n’oubliez pas ma recette. — Comment donc, madame ! il faudrait pour cela oublier l’heure de conversation que je viens de passer près de vous : ce qui est tout à fait impossible. Monte-Cristo salua et sortit. Madame de Villefort demeura rêveuse. — Voilà un homme étrange, dit-elle, et qui m’a tout l’air de s’appeler, de son nom de baptême, Adelmonte. Quant à Monte-Cristo, le résultat avait dépassé son attente. — Allons, dit-il en s’en allant, voilà une bonne terre, je suis convaincu que le grain qu’on y laisse tomber n’y avorte pas. Et le lendemain, fidèle à sa promesse, il envoya la recette demandée. |
|
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo |