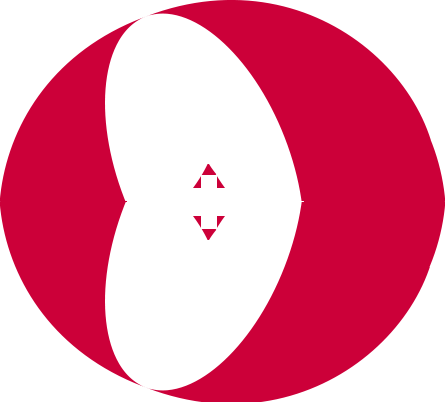LE TEMPS DES DIALECTES
Le morcellement linguistique au Moyen Ă‚ge
L’influence des envahisseurs germaniques, comme on l’a vu, peut expliquer une partie des différences régionales que l’on constate dans les langues parlées au Moyen Âge. (Cf. Langue d’oïl, langue d’oc et francoprovençal, p. 52.) Elle ne peut les expliquer toutes. Comment concevoir, en effet, qu’à partir du latin venu de Rome, on en soit arrivé quelques siècles plus tard à un morcellement linguistique tel que chaque région avait son dialecte ? Car, au Moyen Âge, l’habitant du Limousin ne comprenait pas grand-chose à la langue parlée en Bourgogne, et aucun des deux ne comprenait ce que disait un Parisien. Chacun d’entre eux pratiquait une seule langue, le parler de sa région, et seuls les clercs savaient le latin, qui était, de plus, la seule langue écrite.
Pour essayer de s’expliquer comment s’est produite cette différenciation en dialectes divers, il faut se rappeler les conditions de vie sous le régime féodal. Fondée sur les relations de vassal à suzerain, la vie s’organisait sur la terre du seigneur, autour du château. Le seigneur était ainsi amené à avoir de multiples rapports avec les paysans, dont il devait pouvoir se faire comprendre, mais il ne fréquentait guère ses pairs, sinon à de rares occasions. C’est donc à l’intérieur des limites d’un fief qu’ont dû naître et se développer des divergences, d’abord minimes, mais qui ont pu s’accentuer lorsque les conditions géographiques augmentaient l’isolement de deux domaines contigus. Inversement, dans le cas où des contacts entre deux communautés voisines pouvaient s’établir et se multiplier, chaque communauté adaptait son parler au parler de l’autre, empêchant ainsi les différences de se creuser. Les villes de marché, avec leurs foires, qui drainaient à certaines périodes des gens de divers domaines, agissaient aussi dans le sens de l’uniformisation.
Il y a donc des différences, plus ou moins accidentelles, entre des aires dialectales voisines, telles qu’on peut les reconstituer pour le Moyen Âge. Leurs limites exactes ne peuvent pas être précisées : elles dépendent à la fois des conditions géographiques naturelles et des voies de communication, mais aussi des frontières ecclésiastiques et des relations politiques entre les seigneurs.
Paris s’éveille
La survivance dans la France contemporaine de ces divers parlers, surtout dans les milieux ruraux, ne donne qu’une idée très approximative de ce qu’était le pays au Moyen Âge, car aujourd’hui le français règne partout, alors qu’à cette époque il n’était qu’un dialecte parmi d’autres.
La langue commune ne serait peut-être pas aujourd’hui le français s’il ne s’était produit à la fin du Xe siècle un événement capital pour l’histoire de ce dialecte : en 987, Hugues Capet est élu roi par les grands du royaume, soutenus par les représentants de l’Église. Or, Hugues Capet était duc de France, c’est-à -dire de ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ile-de-France, et son duché, qui deviendra le domaine royal, est très réduit. On peut voir sur la carte (cf. p. 89) qu’il se limite à Paris et à ses alentours immédiats, à une partie de l’Orléanais et du Vermandois, à la région d’Attigny sur l’Aisne et à une petite fenêtre sur la Manche près de Montreuil (Pas-de-Calais).
Quelque deux cents ans plus tard, à l’avènement de Philippe Auguste, en 1180, le domaine royal s’est considérablement agrandi autour de Paris, surtout en direction du sud et de l’est.
En consultant une carte routière, on peut retrouver facilement autour de Paris toute une série de localités, telles que Baillet-en-France, Belloy-en-France, Bonneuil-en-France, Châtenay-en-France, Puiseux-en-France et bien entendu Roissy-en-France, qui témoignent de l’emplacement de l’ancien duché et qui rappellent la plus ancienne implantation franque dans notre pays. (Cf. carte, p. 89, dans la partie agrandie.)
Pourquoi Paris ?
Reste à comprendre pourquoi le parler de Paris a fini par l’emporter. Un ensemble de circonstances a dû jouer dans ce sens.
Géographiquement, Paris avait une position très favorisée. Située à proximité du confluent de trois cours d’eau importants, la Seine, l’Oise et la Marne – d’où son nom « Ile » de France –, la région parisienne semble avoir très vite formé le centre naturel d’un domaine linguistique qui s’étendait à la fin du Moyen Âge jusqu’à la Loire. À l’ouest Blois et Tours, à l’est Troyes et Reims ont des parlers peu différents de ceux de Paris(69).
À cette situation géographique exceptionnelle, il faut ajouter des raisons économiques et culturelles : la proximité immédiate d’une région très fertile, le grenier à blé que constituent la Beauce et la Brie, et un peu plus tard le mouvement littéraire, soutenu par la Cour, qui a contribué à rehausser le prestige de la langue de l’Ile-de-France. La littérature qui naît dans cette région à la fin du xf siècle comprend au début surtout des chansons de geste, sortes de longs poèmes épiques qui étaient chantés par des jongleurs dans les foires ou les réunions populaires. C’était une littérature qui exaltait les exploits d’hommes exceptionnels, écrite dans une langue sans recherche excessive, car elle devait être comprise par le peuple.
À partir du XIIe siècle prend naissance un nouveau genre, le roman « courtois », où, sous l’influence de la littérature des pays d’oc, s’expriment des sentiments délicats, avec des raffinements dans l’expression que ne connaissent pas les chansons de geste. Le poète – troubadour dans le sud, trouvère dans le nord du pays – y fait inlassablement sa cour à la dame de ses pensées, dans une langue pleine de subtilités, qui enthousiasme la noble société des châteaux.