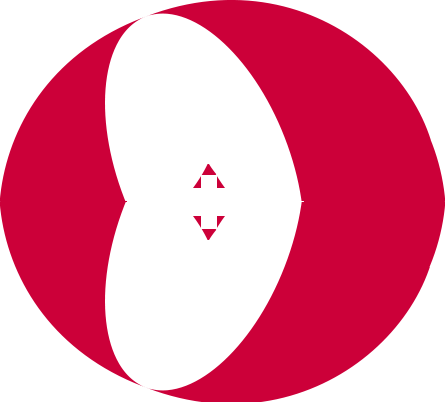L’INTERMÈDE VIKING
Les Vikings, des Germains venus du froid
Alors que notre langue s’engageait dans la voie d’une relatinisation partielle, de nouveaux envahisseurs, venus du froid, allaient abandonner leur propre langue pour adopter la nôtre.
C’est tout au début du IXe siècle que les Vikings, ces grands hommes blonds descendus de Scandinavie, font leurs premiers raids sur les côtes de la Manche et poussent leurs incursions à l’intérieur des terres, parfois jusqu’à Paris et même jusqu’en Bourgogne(61). En 911, le roi Charles le Simple finit par leur céder une partie du littoral de la Manche, celle qui deviendra le duché de Normandie. À partir de ce moment, ces Normands (ou « hommes du nord »), installés sur leurs propres terres, renoncent définitivement au pillage et s’intégrent à la population. Comme ils étaient venus sans femmes, ils épousent les belles indigènes et leurs coutumes, et finissent par adopter leur langue. Leurs enfants apprennent donc à parler la langue romane de leur mère, si bien qu’après 940, aucun document écrit ne permet de confirmer que la langue Scandinave vivait encore sur le territoire(62).
Au bout de trois générations, l’intégration des Normands est définitive, et c’est même grâce à eux que notre langue va traverser la Manche. En effet, Guillaume le Normand conquiert l’Angleterre en 1066, partage le pays entre ses barons, et le français y devient la langue de l’aristocratie, de la Cour, des tribunaux et de la religion. On retrouve d’ailleurs facilement dans le vocabulaire anglais l’origine française de toute une série de termes introduits en anglais à cette époque, dans le domaine politique (crown, council, count, court, duke, justice, obedience…), dans le domaine ecclésiastique (abbot, cardinal, charity, grâce, mercy, pilgrim, sacrament…) ou dans celui de la vie courante (catch, county, pay, peace, poor, poverty, rich, treasure, wait…)(63).
Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre à la fin du XIIe siècle, pour qui combattait son contemporain légendaire Robin des Bois, parlait français. Il est vrai qu’il était le fils d’Aliénor d’Aquitaine, devenue reine d’Angleterre après son divorce d’avec le roi de France Louis VII. Il faut attendre le début du XVe siècle pour trouver en Angleterre un roi, Henri IV de Lancastre, qui pratique l’anglais comme langue maternelle(64). Aujourd’hui encore, les armoiries de la Grande-Bretagne portent, en français, l’inscription : « Dieu et mon droit ». De même, la plus haute distinction de la noblesse anglaise, l’ordre de la Jarretière, conserve respectueusement comme devise l’exclamation du roi Édouard III, renouant, au cours d’un bal, la jarretière de sa maîtresse : « Honni soit qui mal y pense. » On était en 1347, en plein XIVe siècle, et le roi d’Angleterre, comme toute sa cour, ne parlait pas moins français que son cousin, le roi de France Philippe VI, qu’il venait de battre à Crécy.
De plus, c’est en Angleterre que Palsgrave fait paraître en 1530 la première grammaire française, rédigée bien entendu en anglais, pour les habitants de cette Angleterre où l’on continuera à rendre la justice en français jusqu’au milieu du XVIIIe siècle (1731)(65).
On peut se demander ce qu’il serait advenu de la situation linguistique de la France et de l’Angleterre si Jeanne d’Arc n’avait pas réussi à « bouter les Anglois hors de France » et si les Anglais avaient finalement triomphé. Dans ce cas, le roi d’Angleterre serait devenu légalement le roi de France et le français aurait eu de grandes chances de devenir la langue officielle des deux royaumes. Mais ne peut-on pas aussi imaginer un conflit prolongé entre les deux langues qui aurait pu aboutir à la situation présente ?
Le français enrichit l’anglais (ou le franglais à rebours)
Les Normands ont en tout cas marqué d’une forte empreinte française la langue anglaise, dont le lexique porte encore aujourd’hui la marque de leur passage.
D’une manière générale, les mots d’origine française (normande) correspondent à des usages plus recherchés, souvent plus spécialisés ; ceux d’origine anglo-saxonne, à des usages plus familiers, plus adaptés aux réalités pratiques. Il suffit de comparer, par exemple :
|
to combat et to fight |
to finish et to end |
|
to conceal et to hide |
to gain et to win |
|
cordial et hearty |
to mount et to go up |
|
economy et thrift |
to perish et to die |
|
egotism et selfishness |
to retard et to keep back |
|
to expectorate et to spit |
to tolerate et to put up with |
De même, pour la fleur cultivée, c’est le mot fleur qui est à l’origine de flower, tandis que bloom et blossom, d’origine germanique, désignent les fleurs des arbres. Pour les préparations culinaires élaborées, on trouve veal, mutton et beef (du français veau, mouton et bœuf), en opposition aux formes traditionnelles germaniques calf, sheep et ox, qui désignent les animaux sur pied.
Les emprunts ont continué jusqu’à ce jour. Aux XIIIe et XIVe siècles, à l’époque où les classes supérieures étaient effectivement bilingues, ils ont été considérables. Parmi beaucoup d’autres, on peut citer :
– bachelor (vx fr. bachelier « aspirant chevalier », puis « célibataire ») ;
– bargain (vx fr. bargaignier « commercer, hésiter » > barguigner) ;
– constable (vx fr. cunestable > connétable) ;
– foreign (vx fr. forain) ;
– purchase (vx fr. pourchacier « tenter d’obtenir ») ;
– squire (vx fr. esquier > écuyer), etc.
Voici encore, avec leur orthographe anglaise, au milieu de milliers d’autres, des mots passés du français en anglais :
|
LE « FRANGLAIS » À REBOURS C’est notamment à partir de la conquête normande (1066) que des centaines de mots français ont été introduits dans la langue anglaise. Le français, en Angleterre, est pendant quelques siècles la langue de la classe dirigeante et, en 1298, on affirme encore qu’en Angleterre, « à moins de connaître le français, on n’est guère considéré ». Certains mots empruntés à l’ancien français sont aujourd’hui méconnaissables : – caterpillar « chenille », de l’ancien français chatepelose « chatte poilue » – duty « devoir », de dueté, ancien dérivé de devoir – parson « curé », de personne (de rang important) – match « allumette », de l’ancien français meiche « mèche » – mushroom « champignon », de mousseron – plenty « beaucoup », de l’ancien français aplente « à foison » – toast « tranche de pain grillé », de l’ancien français toster « rôtir » – fuel « combustible », de l’ancien français fouaille « ce qui alimente le foyer ». Les emprunts au français dans les mots suivants sont plus aisés à reconnaître. Ils ne font généralement pas double emploi avec le vocabulaire d’origine anglo-saxonne.
|
au XVIe s. – promenade, colonel, portmanteau, moustache, scene, vogue, etc.
au XVIIe s. – dishabille, liaison, repartee, burlesque, bureau, brunette, cabaret, concierge, fiacre, double entendre, nom-de-plume, faux pas…
au XVIIIe s. – bouquet, boulevard, connoisseur, liqueur, envelope, nuance, souvenir, carte blanche, fauteuil, brochure, picnic…
au XIXe s. – format, cliché, chef (de cuisine), menu, restaurant, gourmet, secretaire, entente, parvenu, blasé, bête noire…
au XXe s. –garage, crêpe, dressage, existentialism…(66)
Aujourd’hui encore se manifestent donc quotidiennement dans la langue anglaise les effets de cette langue française transportée en Angleterre par les Normands, il y a plus de neuf cents ans. (Cf. encadré, p. 83 et également p. 201.)
Les témoignages de l’invasion normande
Ces pillards normands devenus gentilshommes avaient donc très vite abandonné leur propre langue Scandinave, cousine germanique de l’anglais et de l’allemand. Les enfants, élevés par leur mère, d’origine française, ne l’ont pas apprise. Pourtant, cette langue Scandinave n’a pas disparu sans laisser quelques vestiges, modestes mais toujours présents, dans le français d’aujourd’hui : quelques dizaines de noms de familles et de lieux (cf. encadré, p. 85), ainsi que quelques éléments lexicaux, essentiellement dans le domaine maritime.
Balbec, ou la géographie imaginaire de Marcel Proust
Le mot signifiant « ruisseau » apparaît sous la forme -bec (cf. allemand Bach « ruisseau ») dans de nombreux noms de lieux normands : Caudebec (Eure), Annebec (Calvados), Bolbec (S.-M.), Houlbec (S.-M.), Beaubec (S.-M.), etc. Mais il faut résister à la tentation d’ajouter à cette liste de toponymes le plus célèbre d’entre eux, Balbec, qui tient une si grande place dans À la recherche du temps perdu. Vous ne le trouverez pas sur la carte, car il n’existe pas.
Seuls, sans doute, les spécialistes de l’œuvre de Proust savent que Balbec est une création du romancier : il en a fait une ville où se confondent et s’amalgament de façon impressionniste les paysages et les monuments de Trouville, de Cabourg, de Dives, et peut-être d’autres lieux encore(67).
QUELQUES TOPONYMES D’ORIGINE SCANDINAVE
Des noms de villes aux sonorités aussi françaises que Honfleur, Harfleur ou Barfleur n’ont rien à voir avec les fleurs, car leur élément final provient d’un mot scandinave signifiant « baie, crique ».
Dans le toponyme Le Houlme, on retrouve le même suffixe -holm « rivage, île » que dans Stockholm, et dans Le Torp Mesnil, torp signifie « village ».
Un autre mot, toft, signifiant « ferme », puis « village », a servi à former un grand nombre de noms de lieux normands :
Esquetot (Eure), « la ferme du frêne » (cf. anglais ashtree « frêne »).
Appetot (Eure), « la ferme du pommier » (cf. anglais apple « pomme »).
(On trouve d’ailleurs le même toponyme au Danemark, sous la forme Æbeltoft « la ferme du pommier », dans le Jutland.)
Lintot (Seine-Mar.), « la ferme du tilleul » (cf. allem. Linden « tilleul »).
Robertot (Seine-Mar.), « la ferme de Robert », de même Yvetot, etc.(68).
Les quelques mots français d’origine scandinave
Au contact des Vikings, c’est le vocabulaire de la mer qui s’est enrichi d’une série de mots qu’utilisent aujourd’hui surtout les amateurs de voile : cingler « faire voile », hauban « cordage maintenant un mât », hune « plate-forme reposant sur un mât », (prendre un) ris « (diminuer) la surface de la voilure ». Plus largement répandus sont des mots comme le turbot (le poisson) et surtout la vague. Tels sont les petits cadeaux posthumes que nous ont finalement laissés en héritage ces populations, venues à l’origine pour voler et piller.