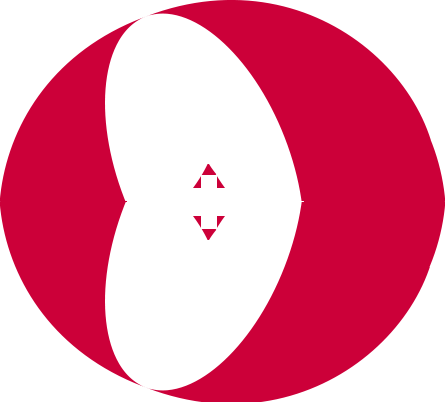LE TEMPS DES « BARBARES »
Du latin au français
L’occupation romaine de la Gaule avait, pendant plus de cinq cents ans, apporté aux habitants de ce pays une nouvelle langue, en même temps qu’une autre civilisation. Le pays avait été organisé, l’économie s’était développée, des routes avaient été construites et tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes si ne s’était produit le grand bouleversement des invasions. Entre la chute de l’Empire romain (476) et l’apparition de ce qu’on a appelé le premier « monument » de la langue française, le texte des Serments de Strasbourg (842), ce sont près de quatre siècles d’obscurantisme pour les populations, qui sont pour nous quatre siècles d’obscurité, faute de documents.
C’est pourtant une période décisive pour l’histoire du français, car c’est celle où s’est développé le processus de différenciation et de dialectalisation, trop rapidement esquissé dans le préambule, et sur lequel il convient à présent de revenir.
Malgré la rareté des documents relatifs à cette période, nous allons chercher à utiliser les maigres données historiques que nous pouvons réunir, pour tenter de reconstituer la situation linguistique des populations et nous efforcer de comprendre comment ont pu se produire les changements dont nous constatons l’aboutissement au début du IXe siècle.
Deux faits historiques attestés nous serviront de points d’appui : les invasions germaniques, et en particulier celle des Francs, parce que la langue de ces envahisseurs a eu des effets particulièrement sensibles sur ce qui est devenu plus tard le français, et, en contrepoint, la diffusion du christianisme, dont la langue liturgique était devenue officiellement le latin au IVe siècle(21).
La Provence, première province romaine
Pour se rendre compte de l’ensemble de la situation, il faut tout d’abord se rappeler qu’au moment de l’arrivée de Jules César, en 58 avant J.-C., les Romains étaient déjà installés au sud de la Gaule depuis une soixantaine d’années. Vers 120 avant J.-C., ils y avaient fondé une province, appelée Provincia Narbonensis, la Narbonnaise, qui recouvrait les régions actuelles de la Provence, du Languedoc, du Dauphiné et de la Savoie (à l’exception des hautes vallées). La romanisation y avait été rapide, profonde et durable(22).
Cette région, qui avait été une des zones où les Gaulois avaient eu le moins d’influence(23) sur les populations ligures qui occupaient le pays avant eux, est aussi celle qui subira le moins l’influence germanique. Cela explique en partie le fait que les dialectes provençaux sont restés très proches du latin.
Les invasions germaniques
En mettant donc à part la zone correspondant à l’ancienne Provincia, qui semble avoir particulièrement bien résisté à toutes les influences ultérieures, les seuls envahisseurs qui entrent en ligne de compte pour l’histoire générale de la langue aux alentours du Ve siècle sont des populations germaniques :
– les Francs ;
– les Wisigoths ;
– les Burgondes. (Cf. carte, p. 50.)
Pour la variété linguistique qui a abouti au français, ce sont les Francs qui ont joué le rôle le plus important, et on peut le comprendre si on se rappelle que leur implantation en Gaule s’est prolongée pendant des siècles.