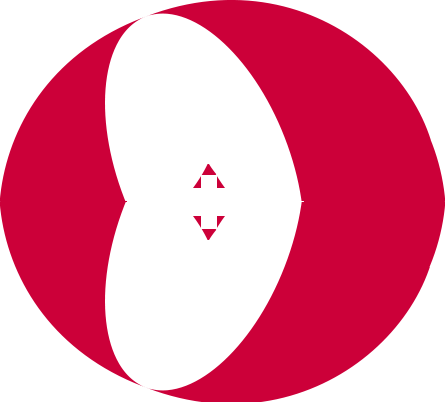| Приобрести Курс Знаток |
DIX POINTS DE REPÈRE
À la recherche des origines
Le français n?a pas toujours existé, comme la France n?a pas toujours eu les mêmes frontières, mais la date de naissance de cet enfant du latin reste entourée de mystère. C?est seulement vers le IXe siècle, mille ans après la conquête de la Gaule en 51 avant J.-C., que nos ancêtres se sont aperçus que ce latin qu?ils croyaient parler était, à leur insu, devenu du français.
Mais depuis quand ?
Il est difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c?est que pendant des siècles nos ancêtres ont été contraints de vivre avec leurs voisins romains, francs, burgondes, wisigoths ou normands, et ils ont bien dû, entre deux affrontements, discuter avec eux, partager leurs repas et, éventuellement, courtiser leurs filles. Tout cela avec des problèmes d?intercommunication, car, à l?origine, ces gens ne parlaient pas tous la même langue.
Le français résulte en partie de toutes ces rencontres et de tous ces contacts.
Les mots ne se prononcent plus de la même façon
Les mots qu?employaient nos ancêtres sont venus jusqu?à nous, mais ils ont subi les outrages du temps et nous avons quelquefois du mal à les reconnaître. Le mot muer français ne ressemble plus beaucoup au mot latin mutare d?où il est issu. Mais, si on analyse les anciens manuscrits, on peut reconstituer les étapes par lesquelles le mot a pu passer. Au VIIIe siècle(3), l?usage de la graphie dh pour représenter un t latin entre deux voyelles (mutare > mudhare) montre que cette consonne s?est affaiblie. Elle se prononçait probablement comme le d de nada en espagnol contemporain. Au cours des siècles suivants, cette consonne, déjà faiblement articulée, s?est encore atténuée pour disparaître complètement, au plus tard vers le XIe siècle :
MUTARE ?> mudhare ?> mudher ?> muer
Ainsi, de mutare on est passé à muer, mais, jusqu?au XIVe siècle, cet infinitif muer se prononçait en faisant sonner la consonne finale, comme aujourd?hui dans le mot fer. Cette consonne finale, à son tour, commence à connaître des faiblesses pendant le XIVe et le XVe siècle, pour aboutir à la prononciation d?aujourd?hui, sans r final prononcé : muer à l?infinitif se prononce dès lors comme mué au participe passé. Nous reparlerons plus loin des avatars de cette consonne finale au XVIe siècle. (Cf. p. 96-99.)
Dans ce cas, l?évolution a modifié la forme du mot ; dans d?autres cas, c?est le sens qui a changé.
Les mots n?ont plus le même sens
Les Romains avaient deux mots pour désigner la ? tête ? :
? un mot noble, CAPUT, qui a évolué phonétiquement pour donner le mot français chef d?abord avec le sens de ? tête ?, en ancien français, ensuite avec celui de ? la personne qui est à la tête, le dirigeant ? ;
? un mot familier, TESTA, qui à l?origine signifiait ? pot de terre ?.
Les Romains parlaient en plaisantant de leur testa (leur ? pot de terre ?), un peu comme nous disons vous vous payez ma fiole (Courteline) ou il a pris un coup sur la cafetière. Aujourd?hui le sens de ? pot de terre ? a complètement disparu dans le mot français tête (venant de TESTA). En revanche, tête a gardé tous les sens du mot caput, à la fois ? tête ? et ? celui qui est à la tête ?.
Quant au mot chef, représentant formel du latin CAPUT ? tête ?, il survit encore avec ce sens dans quelques expressions comme couvre-chef ou opiner du chef. Dans la langue, comme dans la nature, rien ne se perd jamais complètement, et l?histoire d?une langue est faite de tous ces mouvements, qui modifient parfois les sons, parfois les sens et parfois les sons et les sens.
Les linguistes parlent d?évolution phonétique quand il s?agit des sons (MUTARE devenu muer) et d?évolution sémantique quand il s?agit des sens (en latin : ? pot de terre ? devenu ? tête ?). Certaines de ces évolutions seront exposées, à titre d?exemples, dans la partie historique de cet ouvrage.
L?histoire de la langue
C?est à travers l?histoire des populations qui ont parlé le français que quelques-unes de ces évolutions seront évoquées. Car l?histoire d?une langue dépend avant tout de l?histoire des gens qui la parlent ou qui ont choisi de la parler. Parmi tous les faits qui ont marqué l?histoire de la France, seuls certains événements, en nombre volontairement réduit, serviront de points de repère. Ils donneront l?occasion d?apporter quelques informations sur les changements linguistiques survenus aux différentes époques et ils aideront à expliquer l?origine de certains de ces changements. Si ces points de repère sont parfois très espacés dans le temps, c?est que, lorsqu?on parle d?évolution linguistique, il faut le plus souvent compter par siècles, si ce n?est par millénaires.
Dix points de repère
Dans la longue histoire des populations qui ont vécu et parlé sur notre territoire, nous ne retiendrons que les événements qui ont eu des conséquences sur la langue.
Nous commencerons par quelques rapides indications sur les langues d?origines diverses qui étaient parlées sur le territoire avant la conquête romaine (AVANT LES ? INDO-EUROPÉENS ?), et en particulier sur le gaulois (le temps des gaulois).
Après l?adoption du latin par les habitants de la Gaule, cette langue se trouvera influencée par les parlers germaniques des envahisseurs (LE TEMPS DES ? BARBARES ?), tandis que le christianisme naissant deviendra l?un des meilleurs agents de propagation de cette langue latine commune (LE TEMPS DES CHRÉTIENS).
C?est à l?époque de Charlemagne que les gens prennent brutalement conscience du fait que la langue qu?ils parlaient depuis toujours n?était plus du latin mais une autre langue, que vont aussi apprendre les envahisseurs normands (L?INTERMÈDE DES VIKINGS).
Pendant tout le Moyen Age, la vie féodale favorisera l?éclosion de parlers régionaux (LE TEMPS DES DIALECTES).
Au XVIe siècle, François Ier donnera à la ? langue françoise ? ses lettres de noblesse : dès lors, elle remplacera le latin comme langue écrite, tandis qu?on continuera à parler patois dans la vie quotidienne (L?AFFIRMATION DU FRANÇAIS).
Mais les grammairiens veillent et, à la fin du XVIe siècle, ils forgent les règles du ? bon usage ?, en prenant modèle sur la langue parlée à la Cour. Ce sont les débuts de la langue ? classique ? (LE TEMPS DU ? BON USAGE ?).
Laissons s?écouler encore un siècle, et ce sera l?époque de la Révolution : la Convention, éprise de centralisation jacobine, portera le premier coup à la vitalité des patois, jugés néfastes pour la République ? une et indivisible ?. Entre-temps, la langue française a aussi voyagé et s?est transportée au-delà des mers (Canada, colonies). Nous en reparlerons dans la partie géographique. (Cf. Le français hors de France).
Enfin, au XXe siècle, l?instruction publique obligatoire et la Première Guerre mondiale (LE TEMPS DE L?ÉCOLE), d?une part, la communication de masse (LE TEMPS DES MÉDIAS), d?autre part, joueront un rôle déterminant dans l?élaboration de la physionomie du français d?aujourd?hui.
Les pages qui suivent exposeront plus en détail les événements que nous venons d?évoquer (Cf. encadré, p. 30) et feront entrevoir, de loin en loin, les métamorphoses de la langue. Ces rappels historiques seront rapides et volontairement superficiels, leur seule raison d?être consistant à montrer l?influence que les événements et les hommes ont pu exercer sur la langue. Ils seront surtout l?occasion de présenter pour chaque époque considérée un ou deux aspects du français sur les plans de la prononciation, de la grammaire et du vocabulaire.
|
LES DIX POINTS DE REPÈRE |
||
|
Idée directrice |
Époque |
Événements |
|
AVANT LES |
Avant |
Les habitants de la Gaule parlaient des langues diverses avant l?arrivée des Gaulois de langue indo-européenne. |
|
LE TEMPS |
?800 à 500 |
Après la conquête de Jules César au Ier siècle avant J.-C., le latin devient progressivement la langue de la Gaule. |
|
LE TEMPS |
IIe-VIe |
Ce latin parlé par les Gaulois est influencé par les envahisseurs germaniques, en particulier par les Francs. |
|
LE TEMPS |
IIe-IXe |
Diffusion du christianisme et naissance de ? l?ancien français ?. Charlemagne restaure l?enseignement du latin. |
|
L?INTERMÈDE |
IXe-Xe |
L?installation des Normands entraîne peu de changements dans la langue. |
|
LE TEMPS |
Ve-XIIe |
La vie féodale favorise la fragmentation dialectale. |
|
L?AFFIRMATION |
XIIe-XVIe |
Diffusion du français. Ordonnance de Villers-Cotterêts : François Ier impose le français écrit, qui détrône le latin. |
|
LE TEMPS |
XVIIe-XVIIIe |
Les grammairiens interviennent pour codifier la langue. Prestige du français à l?étranger. |
|
LE TEMPS |
XIXe-XXe |
Rapport de l?abbé Grégoire à la Convention sur la
nécessité absolue d?abolir les patois. Tous les Français apprennent
le français à l?école. |
|
LE TEMPS |
XXe |
L?action uniformisatrice des médias. |