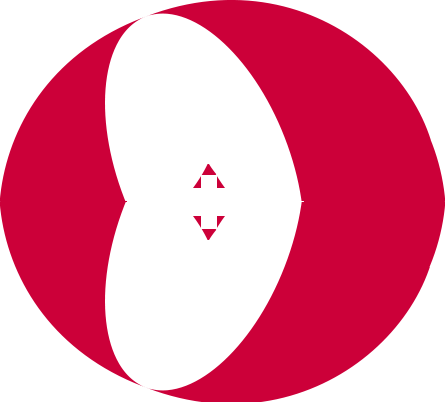| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
PRÉAMBULE
Le français observé par les linguistes
Le français suscite, de la part des Français, les jugements les plus contradictoires : tantôt on le donne en exemple pour ce qu?il a été, tantôt on lui met le bonnet d?âne pour ce qu?il est. Avec beaucoup de passion, on l?encense, on le corrige, on le plaint, on le réprimande. On oublie de le regarder vivre. Derrière ces attitudes excessives, comment redécouvrir le français tel qu?on le parle, tel qu?on l?écrit, tel qu?on l?aime ?
Pour vraiment observer le français dans sa réalité, examinons-le avec l?œil du linguiste. Ou plutôt servons-nous, comme lui, de nos oreilles. Car le linguiste écoute plus qu?il ne s?exprime. Ne lui reproche-t-on pas de s?intéresser davantage à la façon dont les gens parlent qu?à ce qu?ils disent ? À ses interlocuteurs, que cette attitude gêne parfois, ce professionnel du langage apparaît la plupart du temps comme un personnage déconcertant et même un peu inquiétant : il ne laisse rien échapper de ce que vous dites, il a l?air d?en savoir plus long que vous sur votre propre langue et, pourtant, il paraît toujours ravi de ce qu?il entend. Lorsque vous vous rendez compte que son premier souci n?est pas de voir respecter les formes lexicales ou grammaticales, son attitude en quelque sorte amorale de simple observateur vous déconcerte.
Sans nous laisser impressionner par la sévérité à peine exagérée de ces jugements, c?est bien le point de vue du linguiste que nous adopterons dans cet ouvrage : celui de ? l?amateur ? de langues (comme on dit qu?on est amateur de musique ou de peinture). Le linguiste s?intéresse à toutes les langues sous tous leurs aspects, et lorsque son examen porte sur une langue particulière, il cherche essentiellement à préciser en quoi cette langue est différente de toutes les autres langues, comment elle fonctionne et comment elle évolue.
Le but de cet ouvrage est donc surtout de montrer par quels traits historiques, géographiques et structuraux se caractérise le français. Mais tant d?idées reçues circulent sur notre langue qu?on ne pourra pas y voir clair si, auparavant, on ne fait pas un sort à quelques-unes d?entre elles, qui ont la vie dure. Citons pêle-mêle : ? le français, c?est du gaulois ?, ? le français, c?est du latin ?, ? le patois, c?est du français déformé ?, ou ? le français le plus pur se parle en Touraine ?. Dans tout cela, il y a à prendre et à laisser.
Le français, du gaulois ? Certainement pas
Que les Gaulois soient nos aïeux et que la langue gauloise soit l?ancêtre du français, c?est une idée qui a fait les beaux jours de l?école primaire mais qui mérite d?être examinée de plus près.
En fait la Gaule, conquise par les Romains, a adopté la langue de ses conquérants et, en dehors de quelques dizaines de mots d?origine gauloise conservés dans le français d?aujourd?hui et d?un certain nombre de noms de lieux qu?on peut retrouver sur le territoire, le gaulois lui-même est peu et mal connu : les druides transmettaient leur savoir par voie orale et les rares inscriptions parvenues jusqu?à nous sont brèves et répétitives.
Du latin ? Oui, mais quel latin ?
On dit aussi que le latin est l?ancêtre du français, et cela apparaît clairement si l?on compare entre elles les langues romanes, c?est-à-dire les langues qui le perpétuent : italien, français, espagnol, etc. Il faut simplement se rappeler que le parler qui est à la source des langues romanes, ce n?est pas le latin dit classique, qui est la langue écrite des grands auteurs du Ier siècle avant J.-C. (Cicéron, César, Tite-Live, Virgile?), mais le latin dit vulgaire, celui que parlaient les Romains dans leur vie quotidienne(1). Parmi ces langues romanes, le français se définit comme un idiome issu du latin vulgaire importé en Gaule par les conquérants romains.
Pour dire les choses plus exactement, il convient d?insister sur un événement très important survenu ultérieurement. Tous les livres d?histoire enseignent en effet que Jules César a conquis la Gaule vers le milieu du Ier siècle avant J.-C., mais seuls les traités d?histoire de la langue nous informent que cette langue des conquérants, apprise par les Gaulois au contact des légionnaires, des colons et des marchands romains, a ensuite subi l?influence de nouveaux envahisseurs germaniques, et en particulier celle des Francs.
En parlant le latin avec leur ? accent ? germanique, les Francs de la région parisienne ont, en fait, modifié l?apparence de cette langue et contribué à donner son allure générale au parler de l?Ile-de-France, qui est à la source du français actuel. Mais ce n?était à l?époque qu?un parler parmi tant d?autres, qui se distinguait seulement par quelques traits des parlers romans voisins, le normand, le picard ou le berrichon.
Le français : un patois qui a réussi
Lorsqu?une langue se divise en variétés différentes, on a coutume d?utiliser les termes de dialectes ou de patois. C?est ainsi qu?on parle de dialectes et de patois romans pour désigner les différents parlers, locaux ou régionaux, qui proviennent tous du latin de Rome. Ces patois romans étaient issus de la langue que parlaient les envahisseurs romains. Malheureusement le terme de patois en est arrivé progressivement à évoquer dans l?esprit des gens l?idée trop souvent répétée d?un langage rudimentaire et dont certains vont même jusqu?à dire que ? ce n?est pas une langue ?. Nous voilà loin de la définition des linguistes, pour qui un patois (roman) est au départ l?une des formes prises par le latin parlé dans une région donnée, sans y attacher le moindre jugement de valeur : un patois, c?est une langue.
Le latin parlé en Gaule n?a pas abouti à une forme unique, mais s?est diversifié au cours des siècles en parlers différents. Il s?est fragmenté en variétés régionales, les dialectes : on dit qu?il s?est dialectalisé. Lorsque cette diversification a été telle que le parler d?un village ne s?est plus confondu avec celui du village voisin, les linguistes parlent plus précisément de patois. Mais, à leurs yeux, il n?y a aucune hiérarchie de valeur à établir entre langue, dialecte et patois. Un patois et un dialecte ne sont pas moins dignes d?intérêt sur le plan linguistique, mais leur emploi est le plus souvent limité à un usage restreint et ils ne sont généralement parlés que sur des territoires peu étendus.
C?est pourquoi l?idée reçue selon laquelle le patois serait du français déformé doit être vivement combattue et démentie. En réalité, le français, en tant que forme particulière prise par le latin parlé en Ile-de-France, était lui-même à l?origine un patois du latin. Et si l?on constate que cette variété s?est par la suite répandue dans les autres régions pour finalement s?imposer comme la langue du royaume de France, c?est uniquement pour des raisons liées aux institutions et à l?importance prise par la capitale sur les plans politique, économique et administratif. Les autres patois ont simplement eu moins de chance, en restant la langue d?une seule région, voire d?un seul village. Il faut donc bien comprendre que non seulement les patois ne sont pas du français déformé, mais que le français n?est qu?un patois qui a réussi.
Dans la première partie de cet ouvrage, on survolera l?histoire du français, en montrant comment se sont développées les variétés dialectales au cours du temps et pourquoi elles sont souvent aujourd?hui en voie de disparition.
Les trois parties suivantes, consacrées à la diversité géographique, apporteront des précisions sur la localisation de ces variétés dialectales et sur leur plus ou moins grande vitalité à la fois en France et hors de France.
Le deux dernières répondront aux questions : ? Qu?est-ce que le français ? ? et ? Où va le français ? ? On y présentera la structure de la langue telle qu?elle apparaît dans la prononciation, dans la grammaire et dans le vocabulaire, en mettant en lumière les mouvements qui les animent.
Le français de Touraine, ou l?enfant chéri des étrangers
Il existe enfin une tradition selon laquelle le français ? le plus pur ? serait celui que l?on parle en Touraine. Cette idée reçue est d?autant plus inattendue que tous les ouvrages de prononciation française ont au contraire toujours été unanimes pour désigner comme modèle du bon français non pas l?usage des habitants du Val de Loire, mais celui des Parisiens cultivés. Des recherches récentes(2) ont montré que l?origine du prestige attribué au français de Touraine semble se trouver dans les textes écrits par des étrangers, et tout d?abord chez le grammairien Palsgrave qui, au début du XVIe siècle, a écrit en anglais la première grammaire française. Mais ce sont surtout des guides de voyage allemands, hollandais et anglais qui semblent avoir conseillé aux voyageurs de se rendre à Tours, Saumur, Blois ou Orléans pour être sûrs d?y entendre et d?y apprendre le bon français. Cette tradition garde encore quelques échos dans la région, qui conserve et transmet de génération en génération le souvenir des fréquents séjours de la Cour et du roi dans les châteaux de la Loire. Elle a probablement été entretenue aussi par la réputation des écrivains de la Pléiade qui, comme Ronsard, du Bellay, étaient pour la plupart originaires de la région.
Il reste à comprendre pour quelles raisons, au XVIe et au XVIIe siècle, les étrangers ont été amenés à formuler une telle appréciation. La situation linguistique de la France à cette époque peut fournir des éléments de réponse à ce mystère : en effet chaque région parlait à cette époque son propre patois, et le français ne s?était alors encore généralisé qu?en tant que langue écrite. Lorsqu?ils arrivaient en France, les étrangers, qui avaient appris le français dans des livres, ne comprenaient généralement pas les patois que parlaient les habitants des villes et des campagnes. La Touraine constituait une exception : proche de l?Ile-de-France et soumise aux influences parisiennes par les séjours répétés de la Cour dans cette région, on y parlait probablement un patois déjà très francisé. La langue des Tourangeaux ne leur posant pas de problèmes, les étrangers ont donc pu en arriver à la conclusion qu?elle était la plus pure, puisqu?elle était étonnamment proche de celle qu?ils avaient apprise dans les livres.
En opposition à cette tradition, encore vivante chez les étrangers, toutes les enquêtes sur la prononciation qui ont été effectuées depuis le début du siècle, ainsi que toutes les recherches sur des époques plus lointaines à partir des affirmations des grammairiens, établissent que la forme de français qui tend depuis des générations à se répandre est celle qui s?élabore dans le creuset parisien : elle accueille généreusement des éléments de diverses provenances, pour aboutir à un compromis toujours en mouvement entre les divers usages provinciaux et les usages proprement parisiens. Cette tendance est confirmée par les enquêtes sur le terrain qui seront décrites dans la dernière partie de cet ouvrage, intitulée : ? Où va le français ? ?
Le français : un mythe et des réalités
De nos jours, c?est notre propre attitude devant notre langue qui étonne les étrangers lorsqu?ils nous entendent ajouter, après certains mots que nous venons de prononcer : ? Je ne sais pas si c?est français ?, ou même : ? Excusez-moi, ce n?est pas français. ? Cette phrase est si courante chez nous qu?elle n?étonne que les étrangers, surpris, par exemple, qu?un Français se demande si taciturnité ou cohabitateur sont des mots français. En effet, dans les langues voisines, les usagers fabriquent des mots à volonté sans que personne y trouve rien à redire, à condition qu?ils se fassent comprendre. Le Français au contraire ne considère pas sa langue comme un instrument malléable, mis à sa disposition pour s?exprimer et pour communiquer. Il la regarde comme une institution immuable, corsetée dans ses traditions et quasiment intouchable. Nous avons en effet été trop bien dressés à n?admettre un mot que s?il figure déjà dans le dictionnaire. Si nous ne l?y trouvons pas, nous déclarons avec la plus grande conviction, mais contre toute évidence, puisque nous venons de l?employer en étant compris, que ce mot n?est pas français et que, tout simplement, il n?existe pas. Taciturnité et cohabitateur sont deux mots parfaitement conformes aux structures du français et aux règles traditionnelles de formation des mots dans cette langue. Et pourtant, l?auteur du premier, Gabriel Garran, fondateur du théâtre d?Aubervilliers, entendu au cours d?un colloque à Villetaneuse le 14 mai 1986, et celui du deuxième, le fantaisiste Coluche, interviewé à la radio peu de temps avant sa mort en 1986, se sont l?un et l?autre excusés de les avoir employés, en ajoutant qu?ils n?étaient pas français. J?ai cité ces deux cas parce qu?ils ont été récemment cueillis sur le vif, mais ce comportement est absolument général chez tous les Français.
Sur le plan de la prononciation, notre attitude n?est pas moins irrationnelle. Quelle que soit la personne qui parle, c?est toujours l?autre qui a un ? accent ?, qu?on l?appelle accent ? pointu ? ou accent ? méridional ?, accent ? chtimi ? ou accent ? pied-noir ?, ? suisse ?, ? belge ? ou ? canadien ?. Et celui qui parle de ces accents pense que lui-même n?a pas d?accent : c?est toujours l?autre qui est hors norme et qui a tort. Cependant la prise de conscience de cette diversité, quand il ne s?agit que de prononciation, provoque plus souvent le sourire que la réprobation.
Les choses en vont autrement avec la grammaire, et des formes comme ? il s?est rappelé de son enfance ? ou ? il a pallié aux inconvénients ? sont immédiatement rejetées par les puristes comme inadmissibles. Ceux qui les remarquent ne sont pas loin d?accuser ceux qui les emploient soit d?être des individus primaires et incultes, soit d?être responsables de la dégradation sinon de l?assassinat de la langue française : ? France, ton français fout le camp ! ? devient un cri d?alarme et un appel au secours.
Les gens dont le français est la langue maternelle joignent ainsi de façon paradoxale un sens aigu de l?observation (puisqu?ils repèrent sans cesse les écarts vis-à-vis des formes traditionnellement admises) à un refus plus ou moins conscient de reconnaître l?existence de la diversité d?emploi de cette langue. Tout en comprenant parfaitement le sens de telle expression française, à leurs yeux incorrecte, ils n?hésitent pas à déclarer contre toute logique qu?elle n?est pas française.
Comment expliquer cette attitude irrationnelle chez des gens qui se réclament de Descartes ?
Il semble qu?il existe dans l?esprit de tout francophone une dualité qui brouille le paysage. Il a d?une part la conception de cette belle langue française transmise par la tradition à travers les œuvres des grands écrivains et qui prend figure de mythe : n?y touchons pas, on pourrait l?abîmer ! Et, à côté de cette langue idéale, pure, achevée, parfaite, nous avons tous un peu conscience que se développe une autre langue française, que chacun utilise tous les jours sans ménagements, une langue multiple et changeante, s?adaptant au monde moderne et aux situations familières. Il est difficile de l?accepter comme du français, comme ? le français ? ? et pourtant elle s?intégre parfaitement dans la tradition de la langue classique tout en ayant sa propre dynamique : ce qui choque aujourd?hui ne choquera plus demain.
Le mythe est parfaitement entretenu dans les grammaires et les dictionnaires qui enseignent le bon usage : ce sont des points fixes auxquels il est rassurant de se référer en cas de doute. On vérifie, après l?avoir entendue ou employée, si telle tournure ou telle expression est correcte, mais, dans le feu de la conversation ou la hâte d?écriture, on se laisse porter par le génie propre de la langue et on crée des formes nouvelles que la langue autorise mais que l?usage n?a pas consacrées. On s?exprime plus complètement mais on garde mauvaise conscience. Et ces deux perceptions sont si imbriquées dans l?esprit de chacun que, lorsqu?on entend parler de la langue française, on ne sait jamais exactement de laquelle il s?agit.
Dans les pages qui suivent, cette dualité sera toujours présente : on y verra comment a pu naître et se renforcer la conception d?une langue française mythique, réputée belle, claire et achevée, en même temps que se développait et se diversifiait la langue française de tous les jours, avec les qualités et les défauts d?une langue qui fonctionne.