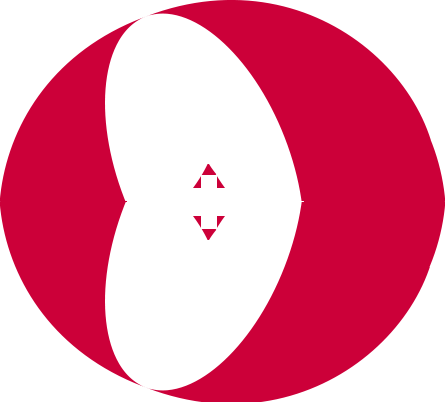| Приобрести Курс Знаток |
PRÉFACE
Les rapports de l?homme avec sa langue sont d?une nature très particulière. Il l?a apprise sans le vouloir. Elle s?est imposée à lui par simple contact avec son entourage. Elle a coïncidé pour lui avec la prise de conscience du monde dans lequel il vit. Comment pourrait-il, dans ces conditions, ne pas identifier le mot et la chose ? Si la chose fait peur, le mot fait peur : qui n?a eu un recul devant le mot cancer, cette ? longue maladie ? à l?issue de laquelle on trépasse. Il y a, à l?inverse, des mots qui transportent de joie parce qu?ils s?identifient avec le plaisir, le bonheur, l?amour, la tendresse. Que signifie ? de bon augure ?, ? de mauvais augure ?, sinon que ce qui est ainsi qualifié va, à un moment donné, correspondre à une réalité ? Sans doute n?y a-t-il plus ici, où intervient déjà la réflexion, coïncidence du mot et de la chose. Mais rien de tel dans la vie de tous les jours, où nous sommes confrontés à des réalités concrètes. Pourquoi dissocierions-nous l?objet arbre et les sons qui le désignent ? Ce serait déjà ratiociner, faire de la ? philosophie ?, perdre contact avec la réalité, et le bon sens nous convainc qu?un arbre est un arbre, tout comme un chat est un chat.
Ce n?est guère qu?au moment où nous apprenons à lire qu?une distanciation va s?établir. Jusqu?alors, un arbre n?était pour nous que la vision d?un tronc surmonté d?un feuillage. On nous offre désormais un équivalent visuellement perceptible sous la forme d?arbre, cinq lettres successives que l?on perçoit vite comme un tout. C?est alors que, pour certains d?entre nous, la langue peut prendre une existence distincte de celle du monde tel que nous le vivons. On ne s?étonnera donc pas que, pour beaucoup ? ou devrais-je dire tout le monde, quelques originaux mis à part ? ? la langue française s?identifie avec sa forme écrite. Cette langue dont, au cours de vos années d?école, vous avez tenté, non sans peine, de maîtriser l?orthographe, ne peut, bien sûr, s?identifier avec les écrits informes de débutants, voire les griffonnages des adultes. Elle n?a trouvé de forme respectable que dans les ouvrages des grands auteurs. Elle représente donc un idéal vers lequel nous devons tendre et qui restera, pour la plupart d?entre nous, inaccessible.
C?est là qu?interviennent les linguistes, ces trouble-fête, qui vont chercher à vous convaincre que la langue existe avant qu?on l?écrive, qu?il y a donc une forme parlée de cette langue dont la forme écrite n?était, au départ, qu?un décalque. Mais ils vont plus loin. Avant de servir à penser, vous disent-ils, la langue vise à communiquer à autrui ce que nous ressentons et percevons, nos besoins, nos désirs, nos exigences. Mais, alors, que devient cet idéal qu?on nous invitait à retrouver dans les monuments de la littérature ?
Qu?on se tranquillise ! Une langue, et la langue française comme toute autre, c?est, tout ensemble, les balbutiements de l?enfant, les audaces lexicales de l?adolescent, les échanges parlés de la ménagère et de son crémier, les discussions entre chercheurs ou philosophes, les prix littéraires de l?année. Tous ces emplois, même les plus humbles, ont des chances de laisser des traces dans son devenir. Elle est, d?autre part, tout ce que l?ont faite des siècles d?usages de tout ordre, des travaux des champs à la littérature, de la vie dans les camps à la diplomatie. Si l?on veut faire plus que la pratiquer, si l?on veut la connaître, la comprendre, il faut l?imaginer dans sa dynamique, celle d?hier et celle d?aujourd?hui, qui peut faire présager de son avenir.
Hormis la somme des ouvrages qu?il faudrait consulter pour satisfaire sa curiosité en la matière, il n?existe, jusqu?à présent, que le livre que nous offre ici Henriette Walter. Pour réussir un panorama si varié, il fallait avoir, comme elle, enquêté auprès d?usagers de tous états, à Paris, à travers la France et la francophonie. Il fallait aussi savoir se renseigner aux meilleures sources, coordonner harmonieusement une foule de données éparses et en donner, pour les non-spécialistes, une présentation à la fois simple et fidèle. Cet ouvrage, si riche, si informatif, n?est pas d?un accès difficile, et, pourtant, quiconque l?aura lu avec la confiance qu?il mérite saura désormais ce qu?est une langue sous tous ses aspects, dans sa structure, dans son fonctionnement, dans ses variétés, ses antécédents et son devenir.
André MARTINET