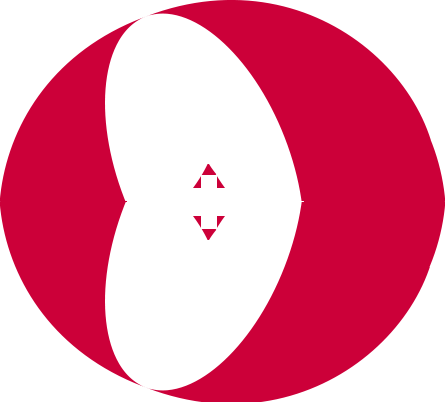| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
|
|
021 Livre Voltaire Zadig ou la Destinée |
|
CHAPITRE XX. L’ERMITE [1]. |
|
Il rencontra en marchant un ermite, dont la
barbe blanche et vénérable lui descendait
jusqu’à la ceinture. Il tenait en main un
livre qu’il lisait attentivement. Zadig
s’arrêta, et lui fit une profonde
inclination. L’ermite le salua d’un air si
noble et si doux que Zadig eut la curiosité
de l’entretenir. Il lui demanda quel livre
il lisait. « C’est le livre des destinées,
dit l’ermite ; voulez-vous en lire quelque
chose ? » Il mit le livre dans les mains de
Zadig, qui, tout instruit qu’il était dans
plusieurs langues, ne put déchiffrer un seul
caractère du livre. Cela redoubla encore sa
curiosité. « Vous me paraissez bien chagrin,
lui dit ce bon père. — Hélas ! que j’en ai
sujet ! dit Zadig. — Si vous permettez que
je vous accompagne, repartit le vieillard,
peut-être vous serai-je utile : j’ai
quelquefois répandu des sentiments de
consolation dans l’âme des malheureux. »
Zadig se sentit du respect pour l’air, pour
la barbe, et pour le livre de l’ermite. Il
lui trouva dans la conversation des lumières
supérieures. L’ermite parlait de la
destinée, de la justice, de la morale, du
souverain bien, de la faiblesse humaine, des
vertus et des vices, avec une éloquence si
vive et si touchante, que Zadig se sentit
entraîné vers lui par un charme invincible.
Il le pria avec instance de ne le point
quitter, jusqu’à ce qu’ils fussent de retour
à Babylone. « Je vous demande moi-même cette
grâce, lui dit le vieillard ; jurez-moi par
Orosmade que vous ne vous séparerez point de
moi d’ici à quelques jours, quelque chose
que je fasse. » Zadig jura, et ils partirent
ensemble. Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe. L’ermite demanda l’hospitalité pour lui et pour le jeune homme qui l’accompagnait. Le portier, qu’on aurait pris pour un grand seigneur, les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse. On les présenta à un principal domestique, qui leur fit voir les appartements magnifiques du maître. Ils furent admis à sa table au bas bout, sans que le seigneur du château les honorât d’un regard ; mais ils furent servis comme les autres avec délicatesse et profusion. On leur donna ensuite à laver dans un bassin d’or garni d’émeraudes et de rubis. On les mena coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d’or, après quoi on les congédia. « Le maître de la maison, dit Zadig en chemin, me paraît être un homme généreux, quoique un peu fier ; il exerce noblement l’hospitalité. » En disant ces paroles, il aperçut qu’une espèce de poche très-large que portait l’ermite paraissait tendue et enflée : il y vit le bassin d’or garni de pierreries, que celui-ci avait volé. Il n’osa d’abord en rien témoigner ; mais il était dans une étrange surprise. Vers le midi, l’ermite se présenta à la porte d’une maison très-petite, où logeait un riche avare ; il y demanda l’hospitalité pour quelques heures. Un vieux valet mal habillé le reçut d’un ton rude, et fit entrer l’ermite et Zadig dans l’écurie, où on leur donna quelques olives pourries, de mauvais pain, et de la bière gâtée. L’ermite but et mangea d’un air aussi content que la veille ; puis s’adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux pour voir s’ils ne volaient rien, et qui les pressait de partir, il lui donna les deux pièces d’or qu’il avait reçues le matin, et le remercia de toutes ses attentions. « Je vous prie, ajouta-t-il, faites-moi parler à votre maître. » Le valet étonné introduisit les deux voyageurs : « Magnifique seigneur, dit l’ermite, je ne puis que vous rendre de très-humbles grâces de la manière noble dont vous nous avez reçus : daignez accepter ce bassin d’or comme un faible gage de ma reconnaissance. » L’avare fut près de tomber à la renverse. L’ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement, il partit au plus vite avec son jeune voyageur. « Mon père, lui dit Zadig, qu’est-ce que tout ce que je vois ? Vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes : vous volez un bassin d’or garni de pierreries à un seigneur qui vous reçoit magnifiquement, et vous le donnez à un avare qui vous traite avec indignité. — Mon fils, répondit le vieillard, cet homme magnifique, qui ne reçoit les étrangers que par vanité, et pour faire admirer ses richesses, deviendra plus sage ; l’avare apprendra à exercer l’hospitalité : ne vous étonnez de rien, et suivez-moi. » Zadig ne savait encore s’il avait affaire au plus fou ou au plus sage de tous les hommes ; mais l’ermite parlait avec tant d’ascendant, que Zadig, lié d’ailleurs par son serment, ne put s’empêcher de le suivre. Ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie, mais simple, où rien ne sentait ni la prodigalité ni l’avarice. Le maître était un philosophe retiré du monde, qui cultivait en paix la sagesse et la vertu, et qui cependant ne s’ennuyait pas. Il s’était plu à bâtir cette retraite dans laquelle il recevait les étrangers avec une noblesse qui n’avait rien de l’ostentation. Il alla lui-même au-devant des deux voyageurs, qu’il fit reposer d’abord dans un appartement commode. Quelque temps après, il les vint prendre lui-même pour les inviter à un repas propre et bien entendu, pendant lequel il parla avec discrétion des dernières révolutions de Babylone. Il parut sincèrement attaché à la reine, et souhaita que Zadig eût paru dans la lice pour disputer la couronne. « Mais les hommes, ajouta-t-il, ne méritent pas d’avoir un roi comme Zadig. » Celui-ci rougissait, et sentait redoubler ses douleurs. On convint dans la conversation que les choses de ce monde n’allaient pas toujours au gré des plus sages. L’ermite soutint toujours qu’on ne connaissait pas les voies de la Providence, et que les hommes avaient tort de juger d’un tout dont ils n’apercevaient que la plus petite partie. On parla des passions. « Ah ! qu’elles sont funestes ! disait Zadig. — Ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, repartit l’ermite : elles le submergent quelquefois ; mais sans elles il ne pourrait voguer. La bile rend colère et malade ; mais sans la bile l’homme ne saurait vivre. Tout est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire. » On parla de plaisir, et l’ermite prouva que c’est un présent de la Divinité ; « car, dit-il, l’homme ne peut se donner ni sensation ni idées, il reçoit tout ; la peine et le plaisir lui viennent d’ailleurs comme son être. » Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait raisonner si bien. Enfin, après un entretien aussi instructif qu’agréable, l’hôte reconduisit ses deux voyageurs dans leur appartement, en bénissant le Ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux. Il leur offrit de l’argent d’une manière aisée et noble qui ne pouvait déplaire. L’ermite le refusa, et lui dit qu’il prenait congé de lui, comptant partir pour Babylone avant le jour. Leur séparation fut tendre, Zadig surtout se sentait plein d’estime et d’inclination pour un homme si aimable. Quand l’ermite et lui furent dans leur appartement, ils firent longtemps l’éloge de leur hôte. Le vieillard au point du jour éveilla son camarade. « Il faut partir, dit-il ; mais tandis que tout le monde dort encore, je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection. » En disant ces mots, il prit un flambeau, et mit le feu à la maison. Zadig, épouvanté, jeta des cris, et voulut l’empêcher de commettre une action si affreuse. L’ermite l’entraînait par une force supérieure ; la maison était enflammée. L’ermite, qui était déjà assez loin avec son compagnon, la regardait brûler tranquillement. « Dieu merci ! dit-il, voilà la maison de mon cher hôte détruite de fond en comble ! L’heureux homme ! » À ces mots Zadig fut tenté à la fois d’éclater de rire, de dire des injures au révérend père, de le battre, et de s’enfuir ; mais il ne fit rien de tout cela, et, toujours subjugué par l’ascendant de l’ermite, il le suivit malgré lui à la dernière couchée. Ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de quatorze ans, plein d’agréments et son unique espérance. Elle fit du mieux qu’elle put les honneurs de sa maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d’accompagner les voyageurs jusqu’à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme, empressé, marche au devant d’eux. Quand ils furent sur le pont : « Venez, dit l’ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante. » Il le prend alors par les cheveux, et le jette dans la rivière. L’enfant tombe, reparaît un moment sur l’eau, et est engouffré dans le torrent. « Ô monstre ! ô le plus scélérat de tous les hommes ! s’écria Zadig. — Vous m’aviez promis plus de patience, lui dit l’ermite en l’interrompant : apprenez que sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense ; apprenez que ce jeune homme dont la Providence a tordu le cou aurait assassiné sa tante dans un an, et vous dans deux. — Qui te l’a dit, barbare ? cria Zadig ; et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t’est-il permis de noyer un enfant qui ne t’a point fait de mal ? » Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n’avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d’ermite disparut ; quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. « Ô envoyé du ciel ! ô ange divin ! s’écria Zadig en se prosternant, tu es donc descendu de l’empyrée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels ? — Les hommes, dit l’ange Jesrad, jugent de tout sans rien connaître : tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus d’être éclairé. » Zadig lui demanda la permission de parler. « Je me défie de moi-même, dit-il ; mais oserai-je te prier de m’éclaircir un doute : ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l’avoir rendu vertueux, que de le noyer ? » Jesrad reprit : « S’il avait été vertueux, et s’il eût vécu, son destin était d’être assassiné lui-même avec la femme qu’il devait épouser, et le fils qui en devait naître. — Mais quoi ! dit Zadig, il est donc nécessaire qu’il y ait des crimes et des malheurs ? et les malheurs tombent sur les gens de bien ! — Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours malheureux : ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre, et il n’y a point de mal dont il ne naisse un bien. — Mais, dit Zadig, s’il n’y avait que du bien, et point de mal ? — Alors, reprit Jesrad, cette terre serait une autre terre, l’enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse ; et cet ordre, qui serait parfait, ne peut être que dans la demeure éternelle de l’Être suprême, de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l’autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n’y a ni deux feuilles d’arbre sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel, qui soient semblables, et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l’eau par hasard, que c’est par un même hasard que cette maison est brûlée : mais il n’y a point de hasard ; tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Orosmade t’a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel ! cesse de disputer contre ce qu’il faut adorer. — Mais, dit Zadig [2]…. » Comme il disait mais, l’ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig, à genoux, adora la Providence, et se soumit. L’ange lui cria du haut des airs : « Prends ton chemin vers Babylone. » 1) Fréron (Année littéraire, 1767, I, 30 et suiv.) reproche à Voltaire d’avoir tiré presque mot pour mot ce chapitre d’une pièce de cent cinquante vers, intitulée the Hermite (l’Ermite), par Th. Parnell. Avant Parnell, plusieurs auteurs avaient traité le même sujet, et entre autres l’auteur français Bluet d’Arbères, comte de Permission, dans le livre CV de ses Œuvres ; c’est en 1604 qu’avaient paru les livres CIV et CXIII, dont on ne connaît encore qu’un seul exemplaire, découvert en 1824. (B.) 2) Ce chapitre explique le second titre de Zadig. Le mais philosophique est admirable. (G. A.) |
|
Voltaire Zadig ou la Destinée |