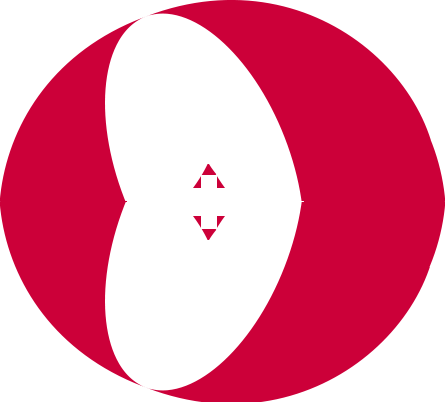| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
|
|
021 Livre Voltaire Zadig ou la Destinée |
|
CHAPITRE XV [1]. LES YEUX BLEUS. |
|
« Le corps et le cœur, dit le roi à Zadig… »
À ces mots le Babylonien ne put s’empêcher
d’interrompre Sa Majesté. « Que je vous sais
bon gré, dit-il, de n’avoir point dit
l’esprit et le cœur ! Car on n’entend que
ces mots dans les conversations de Babylone
; on ne voit que des livres où il est
question du cœur et de l’esprit [2],
composés par des gens qui n’ont ni de l’un
ni de l’autre ; mais, de grâce, sire,
poursuivez. » Nabussan continua ainsi : « Le
corps et le cœur sont chez moi destinés à
aimer ; la première de ces deux puissances a
tout lieu d’être satisfaite. J’ai ici cent
femmes à mon service, toutes belles,
complaisantes, prévenantes, voluptueuses
même, ou feignant de l’être avec moi. Mon
cœur n’est pas à beaucoup près si heureux.
Je n’ai que trop éprouvé qu’on caresse
beaucoup le roi de Serendib, et qu’on se
soucie fort peu de Nabussan. Ce n’est pas
que je croie mes femmes infidèles ; mais je
voudrais trouver une âme qui fût à moi ; je
donnerais pour un pareil trésor les cent
beautés dont je possède les charmes : voyez
si, sur ces cent sultanes, vous pouvez m’en
trouver une dont je sois sûr d’être aimé. » Zadig lui répondit comme il avait fait sur l’article des financiers : « Sire, laissez-moi faire ; mais permettez d’abord que je dispose de ce que vous aviez étalé dans la galerie de la Tentation ; je vous en rendrai bon compte, et vous n’y perdrez rien. Le roi le laissa le maître absolu. Il choisit dans Serendib trente-trois petits bossus des plus vilains qu’il put trouver, trente-trois pages des plus beaux, et trente-trois bonzes des plus éloquents et des plus robustes. Il leur laissa à tous la liberté d’entrer dans les cellules des sultanes ; chaque petit bossu eut quatre mille pièces d’or à donner ; et dès le premier jour tous les bossus furent heureux. Les pages, qui n’avaient rien à donner qu’eux-mêmes, ne triomphèrent qu’au bout de deux ou trois jours. Les bonzes eurent un peu plus de peine ; mais enfin trente-trois dévotes se rendirent à eux. Le roi, par des jalousies qui avaient vue sur toutes les cellules, vit toutes ces épreuves, et fut émerveillé. De ses cent femmes, quatre-vingt-dix-neuf succombèrent à ses yeux. Il en restait une toute jeune, toute neuve, de qui sa majesté n’avait jamais approché. On lui détacha un, deux, trois bossus, qui lui offrirent jusqu’à vingt mille pièces ; elle fut incorruptible, et ne put s’empêcher de rire de l’idée qu’avaient ces bossus de croire que de l’argent les rendrait mieux faits. On lui présenta les deux plus beaux pages ; elle dit qu’elle trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le plus éloquent des bonzes, et ensuite le plus intrépide ; elle trouva le premier un bavard, et ne daigna pas même soupçonner le mérite du second. « Le cœur fait tout, disait-elle ; je ne céderai jamais ni à l’or d’un bossu, ni aux grâces d’un jeune homme, ni aux séductions d’un bonze : j’aimerai uniquement Nabussan, fils de Nussanab, et j’attendrai qu’il daigne m’aimer. » Le roi fut transporté de joie, d’étonnement, et de tendresse. Il reprit tout l’argent qui avait fait réussir les bossus, et en fit présent à la belle Falide ; c’était le nom de cette jeune personne. Il lui donna son cœur : elle le méritait bien. Jamais la fleur de la jeunesse ne fut si brillante ; jamais les charmes de la beauté ne furent si enchanteurs. La vérité de l’histoire ne permet pas de taire qu’elle faisait mal la révérence ; mais elle dansait comme les fées, chantait comme les sirènes, et parlait comme les Grâces : elle était pleine de talents et de vertus. Nabussan, aimé, l’adora : mais elle avait les yeux bleus, et ce fut la source des plus grands malheurs. Il y avait une ancienne loi qui défendait aux rois d’aimer une de ces femmes que les Grecs ont appelées depuis βοῶπις [3]. Le chef des bonzes avait établi cette loi il y avait plus de cinq mille ans ; c’était pour s’approprier la maîtresse du premier roi de l’île de Serendib que ce premier bonze avait fait passer l’anathème des yeux bleus en constitution fondamentale d’État. Tous les ordres de l’empire vinrent faire à Nabussan des remontrances. On disait publiquement que les derniers jours du royaume étaient arrivés, que l’abomination était à son comble, que toute la nature était menacée d’un événement sinistre ; qu’en un mot Nabussan, fils de Nussanab, aimait deux grands yeux bleus. Les bossus, les financiers, les bonzes, et les brunes, remplirent le royaume de leurs plaintes. Les peuples sauvages qui habitent le nord de Serendib profitèrent de ce mécontentement général. Ils firent une irruption dans les États du bon Nabussan. Il demanda des subsides à ses sujets ; les bonzes, qui possédaient la moitié des revenus de l’État, se contentèrent de lever les mains au ciel, et refusèrent de les mettre dans leurs coffres pour aider le roi. Ils firent de belles prières en musique, et laissèrent l’État en proie aux barbares. « Ô mon cher Zadig, me tireras-tu encore de cet horrible embarras ? s’écria douloureusement Nabussan. — Très-volontiers, répondit Zadig ; vous aurez de l’argent des bonzes tant que vous en voudrez. Laissez à l’abandon les terres où sont situés leurs châteaux, et défendez seulement les vôtres. » Nabussan n’y manqua pas : les bonzes vinrent se jeter aux pieds du roi, et implorer son assistance. Le roi leur répondit par une belle musique dont les paroles étaient des prières au ciel pour la conservation de leurs terres. Les bonzes enfin donnèrent de l’argent, et le roi finit heureusement la guerre. Ainsi Zadig, par ses conseils sages et heureux, et par les plus grands services, s’était attiré l’irréconciliable inimitié des hommes les plus puissants de l’État ; les bonzes et les brunes jurèrent sa perte ; les financiers et les bossus ne l’épargnèrent pas ; on le rendit suspect au bon Nabussan. Les services rendus restent souvent dans l’antichambre, et les soupçons entrent dans le cabinet, selon la sentence de Zoroastre : c’était tous les jours de nouvelles accusations ; la première est repoussée, la seconde effleure, la troisième blesse, la quatrième tue. Zadig, intimidé, qui avait bien fait les affaires de son ami Sétoc, et qui lui avait fait tenir son argent, ne songea plus qu’à partir de l’île, et résolut d’aller lui-même chercher des nouvelles d’Astarté. « Car, disait-il, si je reste dans Serendib, les bonzes me feront empaler ; mais où aller ? je serai esclave en Égypte, brûlé selon toutes les apparences en Arabie, étranglé à Babylone. Cependant il faut savoir ce qu’Astarté est devenue : partons, et voyons à quoi me réserve ma triste destinée. » 1) Autre chapitre posthume. 2) Ce trait porte surtout contre Rollin, qui emploie souvent ces expressions dans son Traité des études. Voltaire y revient souvent ; voyez, dans le présent volume, le chapitre ier de Micromégas, et dans le tome XXXIV, le chapitre xi de l’Homme aux quarante écus, le chapitre xi du Taureau blanc ; et dans le tome IX, le 2e vers du chant VIII de la Pucelle. 3) La belle aux grands yeux. |
|
Voltaire Zadig ou la Destinée |