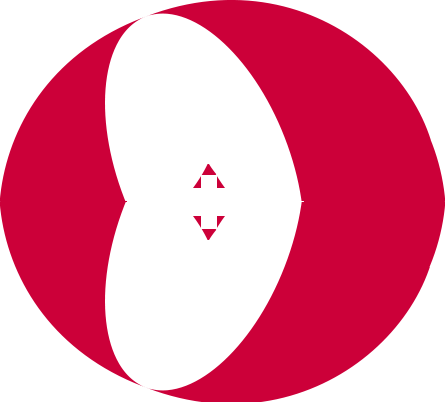| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
|
|
021 Livre Voltaire Zadig ou la Destinée |
|
CHAPITRE VI. LE MINISTRE. |
|
Le roi avait perdu son premier ministre. Il
choisit Zadig pour remplir cette place.
Toutes les belles dames de Babylone
applaudirent à ce choix, car depuis la
fondation de l’empire il n’y avait jamais eu
de ministre si jeune. Tous les courtisans
furent fâchés ; l’Envieux en eut un
crachement de sang, et le nez lui enfla
prodigieusement. Zadig ayant remercié le roi
et la reine, alla remercier aussi le
perroquet : « Bel oiseau, lui dit-il, c’est
vous qui m’avez sauvé la vie, et qui m’avez
fait premier ministre : la chienne et le
cheval de Leurs Majestés m’avaient fait
beaucoup de mal, mais vous m’avez fait du
bien. Voilà donc de quoi dépendent les
destins des hommes ! Mais, ajouta-t-il, un
bonheur si étrange sera peut-être bientôt
évanoui. » Le perroquet répondit : « Oui. »
Ce mot frappa Zadig. Cependant, comme il
était bon physicien, et qu’il ne croyait pas
que les perroquets fussent prophètes, il se
rassura bientôt ; il se mit à exercer son
ministère de son mieux. Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois, et ne fit sentir à personne le poids de sa dignité. Il ne gêna point les voix du divan, et chaque vizir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n’était pas lui qui jugeait, c’était la loi ; mais quand elle était trop sévère, il la tempérait ; et quand on manquait de lois, son équité en faisait qu’on aurait prises pour celles de Zoroastre. C’est de lui que les nations tiennent ce grand principe : Qu’il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citoyens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration il mit ce grand talent en usage. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes ; il avait fait ses héritiers ses deux fils par portions égales, après avoir marié leur sœur, et il laissait un présent de trente mille pièces d’or à celui de ses deux fils qui serait jugé l’aimer davantage. L’aîné lui bâtit un tombeau, le second augmenta d’une partie de son héritage la dot de sa sœur ; chacun disait : « C’est l’aîné qui aime le mieux son père, le cadet aime mieux sa sœur ; c’est à l’aîné qu’appartiennent les trente mille pièces. » Zadig les fit venir tous deux l’un après l’autre. Il dit à l’aîné : « Votre père n’est point mort, il est guéri de sa dernière maladie, il revient à Babylone. — Dieu soit loué, répondit le jeune homme ; mais voilà un tombeau qui m’a coûté bien cher ! » Zadig dit ensuite la même chose au cadet. « Dieu soit loué ! répondit-il ; je vais rendre à mon père tout ce que j’ai ; mais je voudrais qu’il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. — Vous ne rendrez rien, dit Zadig, et vous aurez les trente mille pièces : c’est vous qui aimez le mieux votre père. » Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages, et, après avoir reçu quelques mois des instructions de l’un et de l’autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l’épouser. « Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des deux qui m’a mise en état de donner un citoyen à l’empire. — C’est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l’un. — C’est moi qui ai eu cet avantage, dit l’autre. — Eh bien ! répondit-elle, je reconnais pour père de l’enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. » Elle accoucha d’un fils. Chacun des mages veut l’élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. « Qu’enseigneras-tu à ton pupille ? dit-il au premier. — Je lui apprendrai, dit le docteur, les huit parties d’oraison, la dialectique, l’astrologie, la démonomanie ; ce que c’est que la substance et l’accident, l’abstrait et le concret, les monades et l’harmonie préétablie. — Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d’avoir des amis. » Zadig prononça : « Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. » [1] Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l’itimadoulet de Médie, nommé Irax. C’était un grand seigneur dont le fonds n’était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rarement qu’on lui parlât, et jamais qu’on l’osât contredire. Les paons ne sont pas plus vains, les colombes ne sont pas plus voluptueuses, les tortues ont moins de paresse ; il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs : Zadig entreprit de le corriger. Il lui envoya de la part du roi un maître de musique avec douze voix et vingt-quatre violons, un maître-d’hôtel avec six cuisiniers et quatre chambellans, qui ne devaient pas le quitter. L’ordre du roi portait que l’étiquette suivante serait inviolablement observée ; et voici comme les choses se passèrent. Le premier jour, dès que le voluptueux Irax fut éveillé, le maître de musique entra, suivi des voix et des violons : on chanta une cantate qui dura deux heures, et, de trois minutes en trois minutes, le refrain était : Que son mérite est extrême ! Que de grâces ! que de grandeur ! Ah ! combien monseigneur Doit être content de lui-même ! Après l’exécution de la cantate, un chambellan lui fit une harangue de trois quarts d’heure, dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le dîner dura trois heures ; dès qu’il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit : « Il aura raison. » À peine eut-il prononcé quatre paroles que le second chambellan s’écria : « Il a raison ! » Les deux autres chambellans firent de grands éclats de rire des bons mots qu’Irax avait dits ou qu’il avait dû dire. Après dîner on lui répéta la cantate. Cette première journée lui parut délicieuse, il crut que le roi des rois l’honorait selon ses mérites ; la seconde lui parut moins agréable ; la troisième fut gênante ; la quatrième fut insupportable ; la cinquième fut un supplice : enfin, outré d’entendre toujours chanter : Ah ! combien monseigneur Doit être content de lui-même ! d’entendre toujours dire qu’il avait raison, et d’être harangué chaque jour à la même heure, il écrivit en cour pour supplier le roi qu’il daignât rappeler ses chambellans, ses musiciens, son maître d’hôtel ; il promit d’être désormais moins vain et plus appliqué ; il se fit moins encenser, eut moins de fêtes, et fut plus heureux ; car, comme dit le Sadder [2], toujours du plaisir n’est pas du plaisir. 1) Toute la fin de ce chapitre a paru pour la première fois dans les éditions de Kehl. (B.) 2) Sur le Sadder, voyez tome XI, pages 34 et 199 ; et dans les Mélanges, année 1777, la troisième niaiserie, faisant partie de Un Chrétien contre six Juifs. |
|
Voltaire Zadig ou la Destinée |