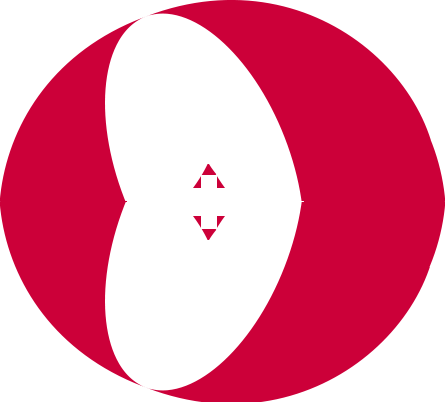| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
|
|
021 Livre Voltaire Zadig ou la Destinée |
|
CHAPITRE I. LE BORGNE. |
|
Du temps du roi Moabdar il y avait à
Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec
un beau naturel fortifié par l’éducation.
Quoique riche et jeune, il savait modérer
ses passions ; il n’affectait rien ; il ne
voulait point toujours avoir raison, et
savait respecter la faiblesse des hommes. On
était étonné de voir qu’avec beaucoup
d’esprit il n’insultât jamais par des
railleries à ces propos si vagues, si
rompus, si tumultueux, à ces médisances
téméraires, à ces décisions ignorantes, à
ces turlupinades grossières, à ce vain bruit
de paroles, qu’on appelait conversation dans
Babylone. Il avait appris, dans le premier
livre de Zoroastre, que l’amour-propre est
un ballon gonflé de vent, dont il sort des
tempêtes quand on lui a fait une piqûre.
Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser
les femmes et de les subjuguer. Il était
généreux ; il ne craignait point d’obliger
des ingrats, suivant ce grand précepte de
Zoroastre : Quand tu manges, donne à manger
aux chiens, dussent-ils te mordre. Il était
aussi sage qu’on peut l’être ; car il
cherchait à vivre avec des sages. Instruit
dans les sciences des anciens Chaldéens, il
n’ignorait pas les principes physiques de la
nature, tels qu’on les connaissait alors, et
savait de la métaphysique ce qu’on en a su
dans tous les âges, c’est-à-dire fort peu de
chose. Il était fermement persuadé que
l’année était de trois cent soixante et cinq
jours et un quart, malgré la nouvelle
philosophie de son temps, et que le soleil
était au centre du monde ; et quand les
principaux mages lui disaient, avec une
hauteur insultante, qu’il avait de mauvais
sentiments, et que c’était être ennemi de
l’état que de croire que le soleil tournait
sur lui-même, et que l’année avait douze
mois, il se taisait sans colère et sans
dédain. Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu’il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémire, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémire l’aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l’Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C’étaient les satellites du jeune Orcan, neveu d’un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était permis. Il n’avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig ; mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n’être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu’il aimait éperdument Sémire. Il voulait l’enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence ils la blessèrent, et firent couler le sang d’une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s’écriait : « Mon cher époux ! on m’arrache à ce que j’adore. » Elle n’était point occupée de son danger ; elle ne pensait qu’à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l’amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémire évanouie et sanglante, qui en ouvrant les yeux vit son libérateur. Elle lui dit : « Ô Zadig ! je vous aimais comme mon époux ; je vous aime comme celui à qui je dois l’honneur et la vie. » Jamais il n’y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémire ; jamais bouche plus ravissante n’exprima des sentiments plus touchants par ces paroles de feu qu’inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l’amour le plus légitime. Sa blessure était légère ; elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement ; un coup de flèche reçu près de l’œil lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait aux dieux que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes : elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards ; mais un abcès survenu à l’œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu’à Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortège. Il visita le malade, et déclara qu’il perdrait l’œil ; il prédit même le jour et l’heure où ce funeste accident devait arriver. « Si c’eût été l’œil droit, dit-il, je l’aurais guéri ; mais les plaies de l’œil gauche sont incurables. » Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d’Hermès. Deux jours après l’abcès perça de lui-même ; Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu’il n’avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point ; mais, dès qu’il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l’espérance du bonheur de sa vie, et pour qui seule il voulait avoir des yeux. Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu’elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orcan la nuit même. À cette nouvelle il tomba sans connaissance ; sa douleur le mit au bord du tombeau ; il fut longtemps malade, mais enfin la raison l’emporta sur son affliction ; et l’atrocité de ce qu’il éprouvait servit même à le consoler. « Puisque j’ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d’une fille élevée à la cour, il faut que j’épouse une citoyenne. » Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville ; il l’épousa, et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l’union la plus tendre. Seulement il remarquait en elle un peu de légèreté, et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d’esprit et de vertu. |
|
Voltaire Zadig ou la Destinée |