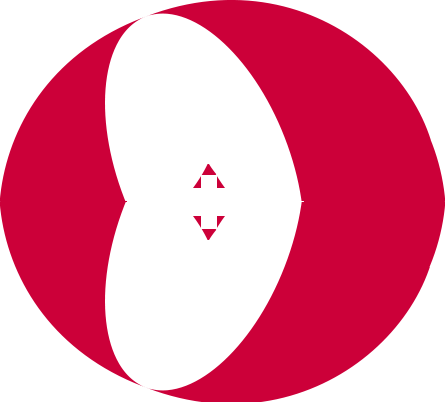| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
|
016 Livre Des contes et légendes |
| 169 Le chat de la mère Michel (2) |
|
Le chat de la mère Michel Le père Jolibois, percepteur des contributions de Chailly, près de Fontainebleau, dormait tranquillement dans un grand fauteuil, lorsque la porte de son bureau, ouverte violemment, donna passage à son jeune clerc, enfant de quinze ans qui, se campant devant lui, s’écria en ouvrant les bras : « C’est-à-dire, Monsieur, que personne ne veut y croire. - Hein ? dit le percepteur réveillé en sursaut, et se frottant les yeux. - Sachez donc que le chat de la mère Michel est mort ! - Et qu’est-ce que tu veux que cela me fasse que le chat de ma mère Michel soit mort ? - Mais si je vous disais que je suis l’héritier de ce chat. - Comment, est-ce qu’il a fait un testament ? Y a-t-il apposé sa griffe ? - Apprenez que, par son testament, mon oncle, qui habitait Moret, avait laissé à la mère Michel une rente de six cents francs, à la charge de nourrir de mou son chat bien aimé, laquelle rente à la mort du chat me revenait ; le chat étant mort, j’hérite, et j’en suis bien heureux, car moi aussi, j’ai un petit chat à élever. - Ah ! ça, c’est donc une maladie dans ta famille que l’amour des chats ? - Oh ! celui-là n’est pas de la même espèce que le défunt ; il n’a pas de griffes. - Je ne te comprends pas. - C’est une histoire que je vous raconterai, si vous le désirez. - Je t’écoute. - Figurez-vous, monsieur Jolibois, qu’il y a un an, vous m’aviez envoyé porter une contrainte à Avon ; en revenant, j’avais pris par le Calvaire, pour gagner la route de Melun, espérant voir, dans le bas Bréau, les écureuils sauter de branche en branche ; il n’y a rien qui m’amuse comme cela. « Quand j’y fus, j’entendis des gémissements en bas, à un endroit où l’on extrait du grès ; tout d’abord j’eus un peu peur, mais, comme les gémissements continuaient, je me suis mis à descendre dans la cavée, et j’arrivai en bas sans m’être fait le moindre mal. Ah ! mon Dieu ! qu’est-ce j’aperçus alors ? Un pauvre ouvrier qu’un éboulement de sable et de grès avait aux trois quarts englouti ; j’approchai, mais lui, d’une voix faible, me dit : « Ne me touche pas ; ma moindre secousse pourrait faire écrouler le reste, mais tiens, là, cherche, tu trouveras quelque chose » ; je suivis la direction de son regard m’indiquait, et, à quelques pas, sur un lit de mousse, de branches et de feuilles, j’aperçus un joli petit enfant qui jouait avec des fleurs fraîchement cueillies dans la forêt. Il riait, le pauvre petit ; il me tendait les bras, je le pris, et son malheureux père me cria d’une voix mourante : « Emporte-le, et va chercher du secours s’il en est temps encore. » « Je me mis à courir du côté de la ville. J’approchais de la barrière, lorsque du haut d’une charrette on me cria : « Ah ! te voilà, paresseux, qu’est-ce que tu fais à cette heure-ci en forêt, au lieu d’être chez ton patron ? » Je regardai, c’était ma tante Geneviève, qui, après le marché, retournait à Montmoreau. Je lui contai ce qui venait de m’arriver. « Bonté divine ! s’écria-t-elle, est-ce bien possible, un pareil malheur ! Donne-moi vite ce pauvre petit chat. » Vous entendez, monsieur Jolibois : ce pauvre petit chat. « Je m’en charge, continua ma tante, je l’emmène à la maison, on pourra l’y retrouver, et puis, cours, cours, mon petit Pierre, amène du monde pour secourir ce brave homme ; tu iras plus vite avec tes deux jambes de quinze ans, qu’avec les quatre pattes du cheval ». Je lui laissai le petit chat, je courus, j’amenai du secours, mais il était trop tard, le pauvre homme était mort, l’enfant était orphelin. - Et qu’est-il devenu ? - Il est toujours à Montmoreau, chez ma tante Geneviève ; nous l’élevons tous les deux. Ma tante n’est pas riche ; alors je l’aide. - Et comment fais-tu ? - Comment ? D’abord, monsieur Jolibois, il y a plus de douze mois que je me suis privé de pain d’épices ; je suis complètement brouillé avec le sucre d’orge ; enfin il n’y a pas jusqu’à ce bon monsieur Fagot, le boulanger qui est tout près de la mairie et qui fait de si beaux petits pains tout chaud le matin, auquel je n’aie ôté ma pratique. Je me contente du pain sec que vous m’offrez tous les jours. Cela fait des économies ; et puis, quand vous me donnez deux sous pour une grande course ; quand un client, afin que ses voisins ne sachent pas qu’il est en retard avec vous, me donne dix sous pour lui remettre en mains propres votre avertissement, je mets tout cela de côté, et, tous les quinze jours, je porte cela à ma tante, pour notre petit chat, qui devient de plus en plus gentil. - Donne-moi la main, tu es un brave garçon ! - Ah ! mais maintenant que je suis légataire universel du chat de la mère Michel ; maintenant que, par testament, je suis propriétaire de six cents francs de rente, c’est pour le coup que, suivant la volonté du testateur, je vais régaler mon petit chat, non pas de mou, comme le défunt, mais avec de bonnes et agréables friandises. Ma tante me l’a dit : « Le hasard t’a envoyé un enfant ; il faut que tu travailles pour en avoir soin. » Eh ! bien, je travaillerai, mais c’est déjà une bonne avance que six cents francs par an ; qu’en pensez-vous, monsieur Jolibois ? - Je pense, mon garçon, que, dimanche prochain, je t’emmènerai dans mon cabriolet ; nous irons voir ta brave tante et ton petit chat, car il m’intéresse aussi, moi, ce pauvre enfant. - Dans votre cabriolet d’osier ? - Dans mon cabriolet d’osier. - C’est ça qui va faire de l’effet à Montmoreau de me voir arriver en cabriolet ! Oh ! monsieur Jolibois, que vous êtes bon ! » Ainsi qu’il l’avait promis à son clerc, car c’était de ce titre pompeux que M. Jolibois qualifiait Pierre Jean, qu’on lui avait confié pour qu’il fît son apprentissage, le dimanche suivant, le percepteur et le jeune garçon montaient le matin dans le fameux cabriolet, et, quelques heures après, entraient triomphalement dans le village de Montmoreau. L’arrivée du cabriolet d’un percepteur le dimanche est un évènement dans un petit pays ; aussi tous les gens assis devant leurs portes disaient-ils avec étonnement : « Tiens, voilà M. Jolibois et son clerc ; il y a donc quelque chose de nouveau. » Eh bien ! madame Geneviève, dit M. Jolibois lorsqu’il eut remisé sa voiture, il s’est passé de grands évènements dans votre maison ! - Quels évènements donc, monsieur le percepteur ? dit Geneviève d’un air surpris. - D’abord, le chat de la mère Michel est mort. - Et ça n’est pas malheureux. Ca n’était-il pas ridicule de voir un chat avoir des rentes pour vivre à ne rien faire, tandis qu’il y a tant d’honnêtes gens qui ont bien de la peine à gagner leur vie. - Et puis, il y a la rencontre qu’a faite mon clerc d’un enfant dans la forêt. - Ah ! le petit ! tenez, le voilà. Regardez si ça n’est pas un vrai amour d’enfant. Viens, petit chat, viens dire bonjour à monsieur le percepteur. » Et l’enfant, accourant, essuya sur la manche de la redingote neuve du percepteur la tartine de beurre qu’il tenait à la main. « Et que comptez-vous faire de cet enfant ? - Tiens, cette question ? Le garder, l’élever comme si c’était à moi. - Mais, c’est une charge de plus pour vous qui n’êtes pas riche ? - Oh bien ! tout s’arrangera, vous voyez que déjà ce vieux rentier de chat, dont Pierre a hérité, vient de mourir ! » Les années s’écoulèrent sans amener de changement, le petit chat grandissait ; il pouvait bien avoir douze ans, quand l’heure vint pour Pierre de faire son service militaire. « Tante Geneviève, dit-il, un jour, à la bonne fermière, il faut que je tire au sort ; mes six cents francs serviront à payer la pension du petit chat au collège d’Avon, et moi je vivrai avec ma solde de militaire. » Pierre amena le numéro 3, et, après avoir confié à sa tante et à M. Jolibois la gestion de sa petite fortune, dans l’intérêt de son fils adoptif, il rejoignit un régiment d’infanterie en garnison dans le Midi. Comme il avait une belle écriture et que le percepteur lui avait appris à bien compter, il devint promptement fourrier, et enfin il partit trois ans après pour l’Espagne avec le grade de sergent-major. Pendant que Pierre se battait contre les Espagnols, au collège, le petit chat, auquel on avait donné le nom de Henri, doué d’une intelligence précoce, avait compris bientôt tout ce qu’il devait de reconnaissance à son père d’adoption, à Geneviève et même à M. Jolibois, que sa douceur et son bon caractère avaient aussi captivé. Il n’avait qu’un seul moyen de s’acquitter envers ces braves gens : c’était de travailler, de s’instruire, et il le fit avec un zèle qui ne se démentit jamais. Il écrivait souvent à Pierre qui lui répondit quelquefois ; cela dépendait du lieu où ses lettres lui parvenaient, mais il y avait longtemps qu’on n’en avait reçu de nouvelles. Un matin d’août, une brillante calèche, attelée de vigoureux chevaux de poste, brûlait le pavé sur la route de Montmoreau ; elle n’était plus qu’à quelques centaines de pas du village, lorsque sa marche fut entravée par une vieille carriole d’osier que traînait un maigre et vieux cheval. |
|
SOMMAIRE Des contes et légendes |