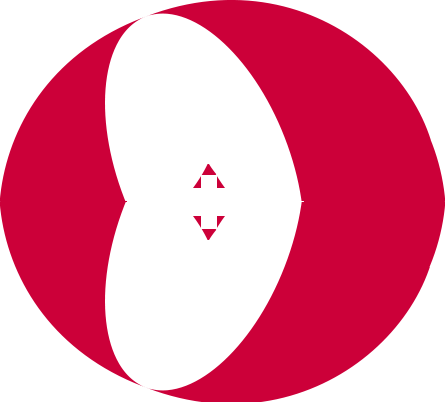| Приобрести Курс Знаток |
 |
|
016 Livre Des contes et légendes |
| 116 L'enseigne patriotique |
|
L'enseigne patriotique Long, mince, sec comme un sapin des Vosges, dans son habit de serge noire, son gilet de drap rouge, son pantalon boutonné sur le côté du haut en bas, Mathias Hafner portait gaillardement cinquante années de bonne humeur et de bonne santé. Son visage était rouge de tuile, et ses petits yeux clignotaient dans l'ombre de son ample tricorne de feutre. Or, les Kougelhopfs de Mathias Hafner jouissaient, dans son village d'Alsace, d'une notoriété gastronomique comparable, toutes proportions gardées, à celle de nos brioches parisiennes de la rue de la Lune. Mathias Hafner, de cette réputation flatteuse, ne tirait aucune apparente gloriole. L'Alsacien, en général, n'a pas le caractère expansif et, aux yeux placides de ses compatriotes, Mathias passait pour un homme froid. Il était, en outre, original et entêté ; il restait, dans l'humble boutique de ses débuts, réfractaire à toute idée d'agrandissement ou d'embellissement. Elle était presque aussi exiguë qu'une échoppe de savetier, cette boutique, et semblait avoir été disposée dans un four ancien et banal. Il y avait une étroite porte à vitraux verts, enchâssés de plomb, et, à côté, s'ouvrait, comme une gueule d'ogre, la voûte en plein cintre de la devanture. Enguirlandée de roses rouges et de houblon, combien attirante était cette jolie devanture, surtout le samedi, avec ses émouvantes architectures dorés, depuis les bizarres lunettes des bretzels, jusqu'aux somptueuses tiares de Kougelhopfs ! Et derrière, blonde, grasse, blanche, les joues en fleur sous le vaste nœud de ruban, Mme Mathias Hafner s'empressait vers la nombreuse clientèle, allait, venait, légère malgré son embonpoint ; et son nœud de ruban, dans la boutique sucrée, battait des ailes comme un gros papillon. Mme Mathias Hafner était une bonne épouse et une excellente mère ; elle avait un fils, pas de fille et peu de tracas, car elle parlait rarement et toujours pour approuver. Aussi attendit-elle cinq ans l'occasion de révéler à son mari le désir ambitieux que la réussite des Kougelhopfs avait fait éclore au plus profond de son cœur. La douce pâtissière souhaitait voir au-dessus de la devanture une belle enseigne neuve en grandes lettres d'or. Comment s'y prit-elle pour persuader son mari ? Profond mystère. Toujours est-il qu'un matin de juillet, des ouvriers fixèrent, à l'aide de fil de fer, de grandes lettres dorées au-dessus du plein cintre, et du coin de la rue, d'un côté, de la place de l'Hôtel-de-Ville, de l'autre, les myopes mêmes purent lire : Pâtisserie. Mme Mathias Hafner, dès lors, parut au comble du bonheur. Son mari restait froid, et, à ceux qui le complimentaient, il répondait dédaigneusement : "Bah ! Ce sont idées de femme !" Le mois suivant, la guerre éclata. Mathias eut ses deux fermes brûlées. Son fils, le petit Fritz, jeune garçonnet de quatorze ans, lui resta seul, tous ses mitrons ayant été mobilisés. Lors de la première tentative d'entrée des Français en Alsace, par miracle, les obus du bombardement respectèrent les lettres dorées de sa boutique. Les Français furent repoussés. Alors héroïquement Mathias resta seul avec sa femme et son petit Fritz. Il fallait vivre, Mathias n'ayant plus de serviteurs et étant à peu près ruiné remit donc la main à la pâte ; les Kougelhopfs et les bretzels meublèrent de nouveau la gueule d'ogre de la devanture. La ville fut envahie d'un silence morne, où éclataient parfois les sonneries des clairons allemands et qu'écrasait, à intervalles réguliers, le pas rythmique et lourd des patrouilles : ein, zwei ! eins, zwei !... (une, deux !... une, deux !...) Tout en travaillant, le pâtissier murmurait : "Les Français reviendront bientôt !" Mathias un jour, entre deux patrouilles, humait le frais au seuil de la boutique, quand il aperçut son voisin Hans Muller, le drapier, qui lui adressait de mystérieux gestes d'appel. Mathias le suivit, et avec des allures de flâneur, les deux homme pénétrèrent dans la Taverne du Mouton d'Or. D'autres buveurs attablés là, devant des mosses écumeux, devisaient à voix basse ; Mathias et son compagnon prirent place parmi eux. En ce coin discret, on commentait les vexations imaginées par les Allemands vainqueurs. Ne voulaient-ils pas contraindre les commerçants à avoir des enseignes allemandes ?... "N'est-ce pas une indignité ? proféra Johann Lindre, le tailleur. Interdire ces enseignes qui, en dépit des casques pointus, maintenaient la nationalité française de nos boutiques ! - C'est monstrueux ! s'écria Hermann Blumen, le bijoutier. - Oui, soupira Mathias Hafner, car nos enseignes protestaient contre leur drapeau. Elles étaient même comme autant de drapeaux de France dont la ville entière se pavoisait ! - Le sinistre spectacle, quand l'allemand s'étalera le long de tous les murs !" gronda Peter Weits, le boucher, en frappant la table de son poing. Hans Muller les apaisa : "Ils tolèrent, jusqu'à nouvel ordre, les anciennes enseignes, mais ils défendent de les réparer, et nul ne pourra les remplacer que par de l'allemand. Veillons donc bien sur nos enseignes !" Alors, Mathias Hafner haussa les épaules : "Les bandits sont encore parlé pour ne rien dire. Avant que nos enseignes soient détruites, nos frères de France nous auront délivrés. - Parbleu !" s'écrièrent-ils tous ensemble. Et, souriant, ils entrechoquèrent leur moss. "Vive la France !" Mais ils se turent aussitôt : Chut ! chut ! Le rythme lourd d'une patrouille approchait ; de leur unique pas automatique - ein, zwei ! ein, zwei ! -les soldats frôlèrent la taverne dont les vitraux frémirent. Avant de rentrer chez lui, Mathias s'arrêta au milieu de la rue pour y contempler son enseigne. Il se frotta les mains et, pénétrant, il appela sa femme. "Catherine !... Écoute, ma Catherine, j'ai eu tort de me moque de toi autrefois, quand tu m'as demandé cette enseigne. C'est une bonne idée que tu as eue, ce mot Pâtisserie fait très bien. La pauvre femme, qui ne souriait plus depuis le commencement de la guerre, s'épanouit de joie. "Tu es content, Mathias ? - Je suis content, Catherine." Un bruit métallique retentit en dehors. "Qu'est cela ? dit Mathias qui sortit. Il rentra tremblant, bouleversé, hagard, tenant une des lettres dorées : c'étaient un i, tout bossué, boueux. Mathias dut s'asseoir. "Mon Dieu !... - Le fil de fer était rouillé, déclara Mme Hafner. En voici du neuf pour raccrocher l'i." Mathias secoua la tête. "C'est défendu Catherine !... Si l'on me voyait, ce serait la destruction immédiate, par autorité de justice, de notre pauvre enseigne... Et ils savent déjà, par leurs espions, qu'une lettre française est tombée, tu peux en être assurée." Mathias demeura un instant prostré. Tout à coup, il se mit à compter sur ses doigts et il se rasséréna. "Encore neuf lettres, Catherine ! A supposer qu'il n'en tombe qu'une par semaine, cela fait plus de deux mois. Et dans deux mois les Prussiens seront chassés !... Mais Hans a raison, soignons nos enseignes." Le lendemain, les patrouilles qui défilèrent dans la rue - ein, zwei ! ein, zwei ! - aperçurent Mathias et le petit Fritz qui, juchés sur une échelle, lavaient, frottaient, astiquaient, graissaient leur enseigne dorée. Hans Muller, Herman Blumen, Johann Linder et gigantesque Peter Weitz agissaient de même. Et tous, partout dans la ville, lavaient, frottaient, astiquaient, graissaient... Pendant deux mois, les prévisions de Mathias Hafner semblèrent se réaliser : son enseigne ne perdit que deux lettres. Il persistait dans sa confiance. "Bah !... Encore huit lettres, et d'ici là !..." Mais, au cours de l'hiver, une autre lettre tomba. Mathias dissimula son inquiétude ; toutefois, le temps coulait, les Français ne se hâtaient guère, et les lettres de ses voisins tombaient ainsi que les siennes, arrachant chaque fois un pétale de la belle fleur d'espoir épanouie au coeur des braves Alsaciens. Un soir de décembre, la neige, qui avait menacé toute la journée, tomba à gros flocons. Le petit Fritz, qui adorait son père, comprenait l'anxiété de Mathias. Cette nuit-là, l'enfant crut entendre gémir l'enseigne et tomber une lettre. Il se dressa hors de son lit, s'habilla à la hâte et descendit à pas de loup pour ne point attirer l'attention de son père et de sa mère. Il ouvrit la porte, s'avança, mais d'énormes flocons de neige dansèrent au tournant de la rue, et, sous ce manteau blanc, une patrouille défila - ein, zwei ! ein, zwei ! L'enfant attendit que les dernières lanterne se fussent éloignées ; puis, couché en deux comme un chiffonnier, à tâtons sur les pavés glissants, il chercha. Il ne s'était pas trompé, une lettre gisait dans le ruisseau. Comme Fritz se relevait, une terrible fusillade éclata non loin de lui et l'enfant aperçut les six Allemands qui composaient la patrouille, rouler les uns sur les autres et ne plus bouger. Presque au même moment, débouchant du détour de la rue, une centaine de soldats français arrivaient au pas de charge et Fritz entendit très nettement ces mots lancés par un gradé : "Et maintenant, mes fistons, à nous la ville, à nous les Boches." Fritz comprit alors que les Français étaient maîtres du pays et, tout joyeux, il rentra chez ses parents, se coucha et rêva la nuit à la victoire de l'armée française. Le lendemain un gai soleil remplaçait la neige et illuminait de ses rayons la devanture de Mathias Hafner ; mais le mot "Pâtisserie", auquel il manquait un i, deux s et un e, portait ce mot si vibrant : "Patrie !" Réné MIGUEL - Mars 1915 |
|
SOMMAIRE Des contes et légendes |