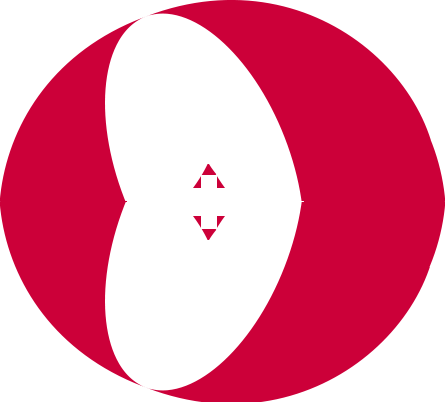| Le Chemin des idées (4) |
|
Nombre de sociologues ont cherché à décrypter cette jeunesse des années
2000. Dans La Mosaïque des générations, le sociologue Jean-Luc
Excousseau qualifie de «momos» - «mobiles moraux» - les jeunes nés entre
1968 et 1978. Mobiles car précaires, ils sont plus mercenaires qu'employés. Mais ils sont également moraux, adeptes des comportements dits «citoyens». Les «momos» sont entrés sur un marché du travail marqué par la morosité. Pas question de sacrifier leur vie personnelle sur l'autel de la réussite professionnelle. Bercés, dès le biberon, par les jeux Mobiles car précaires, ils sont plus mercenaires qu'employés. Jean-Luc Excousseau appelle les plus jeunes, nés entre 1979 et 1990, les «yoyos», les «young yobos», ou jeunes roublards. Ils sont encore peu nombreux sur le marché, mais l'auteur les présente comme de véritables enfants terribles : «20% des effectifs, 80% des problèmes !» Bercés, dès le biberon, par les jeux vidéo et la mode du zapping, les yoyos vivent dans le virtuel et sont loin - très loin - des contraintes de l'entreprise. Facile et plaisante, cette grille de lecture risque de décourager les recruteurs de tout poil qui vont embaucher des «momos» ou des «yoyos»… D'ailleurs, leur avis sur la question est déjà tranché. «Il y a dix ans, lorsqu'on entrait chez nous, on était prêt à se sacrifier, à bouger dans le groupe lorsque le chef le demandait, souligne Élisabeth Valadeau, responsable de la gestion des carrières chez Philips France, où la moyenne d'âge atteint 29 ans. Ça n'est plus le cas : la nouvelle génération est plus casanière.» Si, de tout temps, jeunes et entreprises ont eu des différends, il existe bel et bien, derrière les clichés, une nouvelle donne. D'abord, les jeunes du XXIe siècle ont grandi dans une société de l'information et de la communication. Le choix est leur religion ; leur credo est d' «être acteur de sa vie». D'où un rapport à l'entreprise fondé sur le «donnant-donnant». «Ils ont des exigences nouvelles en termes de confort et de style de vie, affirme Chantal Notarianni, responsable du développement des ressources humaines chez Orange Distribution. Ils entrent chez nous pour ce qu'ils vont en retirer. Ils savent qu'ils ont des droits et entendent les faire respecter. C'est d'abord les droits, puis les devoirs.» Autre changement profond : les jeunes n'ont jamais été tant confrontés à la précarité. «Ils ont vécu les plans sociaux des années 1990 par procuration, rappelle Mickaël Hoffmann-Hervé, directeur de l'Académie des managers, un club de réflexion et de conseils aux dirigeants. Pour eux, l'entreprise n'est plus une providence. Ils ne sont pas dupes.» Cette conscience du chômage de masse et de la fin du mythe de l'entreprise paternaliste a poussé les jeunes à miser de plus en plus sur les études. «J'ai décroché des diplômes parce qu'ils étaient censés être ma garantie antichômage, raconte Lionel, de Génération précaire. Aujourd'hui, j'ai entre les mains des assignats sans valeur et je survis grâce aux Assedic.» |