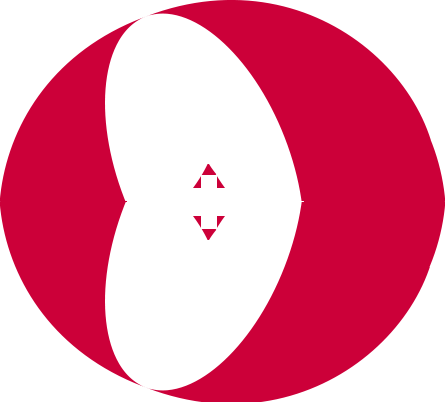DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences
| DALF C2 - Lettres et sciences humaines Niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues |
| Exemple 3 Consignes et indications pour les examinateurs de l’épreuve individuelle (compréhension et production orales) |
| Sujet n°1 1 MONOLOGUE SUIVI : présentation du document - 5 à 10 minutes L’examinateur n’intervient pas. Il peut toutefois, à la fin de la présentation du candidat, avoir recours aux questions proposées dans le document examinateur si le candidat a oublié des éléments importants ou pour lui faire préciser certains points. 1. Héloïse Dufour est tout à fait séduite par la classe inversée pour son aspect moderne et égalitaire. En quoi considère-t-elle ce modèle comme un moyen de lutter contre les inégalités à l’école ? : Pour Héloïse Dufour, avec la classe inversée, le travail à la maison n’implique pas de participation des parents, qui sont, selon les foyers, plus ou moins disponibles ou aptes à comprendre les exercices donnés. De même, il n’exige pas d’enseignants particuliers pour aider aux devoirs, puisque les devoirs consistent souvent en une leçon à regarder, ou un cours auquel se préparer théoriquement, l’heure en classe étant axée sur la pratique. : Elle insiste également sur le fait que la classe inversée favorise les interactions entre professeurs et élèves. Elles sont plus directes, ce qui permet à l’enseignant d’être en contact avec chacun de ses élèves et, ainsi d’être plus attentif à ce qu’il ne « décroche » pas. 2. Quelles conséquences la mise en place de la classe inversée a-t-elle dans le travail de l’enseignant ? : Comme le note la journaliste, la classe inversée demande un investissement plus grand du professeur. Il est beau- coup plus actif dans la classe, puisqu’il ne se contente plus de dispenser un cours. : Vincent Faillet nous explique qu’avec la classe inversée, l’enseignant doit repenser toute la construction de son cours. Il doit trouver des nouveaux moyens de faire accéder aux connaissances à la maison et doit créer des activités pratiques pour la classe, là où, d’habitude, c’est le contraire. Par conséquent, son rôle est aussi de trouver un nouveau moyen de vérifier les connaissances. D’où le recours aux nouvelles technologies. : Héloïse Dufour utilise enfin une expression qui résume bien la situation : l’enseignant passe du « face à face au côte à côte », puisqu’il est, en cours, amené à aider ses élèves à produire quelque chose. 3. Les deux invités de cette émission prônent l’école inversée contre un enseignement dit transmissif. Mais comment définir cet enseignement transmissif ? : Comme le dit Vincent Faillet, le modèle transmissif, c’est le modèle traditionnel qui remonte au Moyen Âge. L’ensei- gnant y est au centre, il dispense un savoir que les élèves reçoivent et écrivent. C’est lui qui donne les leçons et les exercices. : À travers les mots de Vincent Faillet, on peut également le définir a contrario. Le modèle transmissif s’oppose en effet à un modèle contemporain, inspiré du socio-constructivisme, où l’élève construit son savoir avec l’aide de l’enseignant et de ses pairs, comme dans la classe inversée. 4. Au-delà d’une rupture avec un modèle dépassé, qu’est-ce qui séduit tellement les invités dans la démarche de la classe inversée ? : Héloïse Dufour met en avant la flexibilité de la démarche. Chaque enseignant se l’approprie. On peut même pratiquer la classe inversée tout en restant dans un modèle transmissif. Selon elle, cependant, l’intérêt de la démarche est de rendre les élèves actifs en cours, et non plus passifs, face à un enseignant. Ils sont placés en situation de production, dans laquelle les interactions sont permises. C’est, selon elle, l’atout majeur. : La journaliste soulève également un point intéressant. Ce qui séduit peut-être, c’est l’aspect coopératif de la pédago- gie, un aspect souvent absent à l’école alors que la société actuelle, dans le monde du travail en particulier, met de plus en plus l’accent sur la capacité à travailler en équipe, à coopérer. 5. En quoi Vincent Faillet estime-t-il que la coopération est à la fois un outil naturel chez l’élève, et un outil pédagogique bénéfique ? : Vincent Faillet remarque, dans son expérience, que les élèves d’aujourd’hui échangent en permanence, en dehors des cours, de manière informelle, et grâce notamment aux nouvelles technologies, comme, par exemple, sur les réseaux sociaux. : Il note aussi que le fait de favoriser les interactions entre élèves, de leur demander de s’expliquer les choses, peut donner goût à exposer un point de vue et ainsi débloquer la parole de l’élève pour l’inciter à participer. 6. Comment comprendre l’image de l’enseignant bricoleur employée par Vincent Faillet, à la fin de l’interview ? : Vincent Faillet se réfère à une définition du bricolage de Levi-Strauss, c’est-à-dire le bricolage au sens noble du terme. L’enseignant y est considéré comme un artisan, qui construit ses cours en contact avec le réel, avec sa classe, et fait ce qu’il peut avec ce qu’il a. : Il bricole aussi dans le sens où il fait du neuf avec du vieux en réinvestissant ses pratiques dans des nouveaux supports. C’est un bricolage pragmatique, qui vient de la base, c’est-à-dire du terrain, sans impositions des hiérarchies. C’est aussi en cela qu’il est intéressant, selon Vincent Faillet. 2 MONOLOGUE SUIVI : point de vue argumenté - 10 minutes environ Le jury est modérateur de l’émission. Il n’intervient pas. Il invite le candidat à prendre la parole pendant 10 minutes environ pour présenter son point de vue argumenté. 3 EXERCICE EN INTERACTION : débat - 10 à 15 minutes L’examinateur intervient. Il joue le rôle du journaliste et réagit aux propos du candidat. Il doit privilégier le débat et l’échange et ne pas questionner systématiquement le candidat. Il ne doit pas poser de questions qui obligeraient à approfondir un savoir spécifique. |