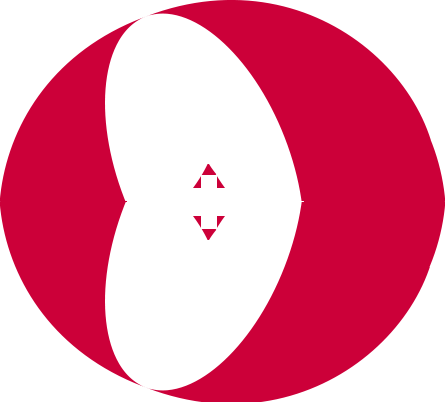DIPLÔME APPROFONDI DE LANGUE FRANÇAISE
| DALF C2 - Sciences / Lettres et sciences humaines Niveau C2 du Cadre européen commun de référence pour les langues |
| Exemple 3 Transcription des documents audio Sujet n°1 NB : L’enregistrement comporte l’ensemble des consignes ainsi que les temps de pause entre les écoutes. Le surveillant ne doit donc pas intervenir sur l’appareil de lecture avant la fin de l’épreuve. |
| Mise en route de l’appareil de lecture] Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 15 minutes environ. Vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Vous êtes invité(e) à prendre des notes. Vous aurez ensuite 3 minutes de pause. Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. Vous aurez alors 1 heure pour préparer votre intervention. Cette intervention se fera en 3 parties : • présentation du contenu du document sonore ; • développement personnel à partir de la problématique proposée dans la consigne ; • débat avec le jury. |
| Première écoute Émission « La classe inversée », Rue des écoles, France Culture Louise Tourret : Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des écoles, le rendez-vous de l’éducation de France culture. Aujourd’hui, la classe inversée, une innovation pédagogique qui rencontre un succès sans précédent. On va vous expliquer de quoi il s’agit, et tenter de comprendre ce que signifie ce succès. » Héloïse Dufour bonjour ! Héloïse Dufour : Bonjour. Louise Tourret : Vous êtes biologiste, militante passionnée de cette pédagogie, vous allez nous expliquer pourquoi le sujet vous passionne. J’ajoute que vous êtes aussi fondatrice d’une association : Inversons la classe. Vincent Faillet, bonjour. Vincent Faillet : Bonjour. Louise Tourret : Vous êtes professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre, vous enseignez au lycée Dorian à Paris, dans le onzième arrondissement, et puis vous menez aussi une activité de recherche en sciences de l’éducation, notam- ment sur la question de la classe inversée, c’est pour ça que vous êtes avec nous aujourd’hui. Héloïse Dufour, donc je le disais, vous êtes biologiste. C’est parce que vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis ces dernières années que vous avez été sensibilisée à la classe inversée, une pédagogie qui est très répandue outre- Atlantique ? Héloïse Dufour : Tout à fait. Donc j’ai passé ces six dernières années aux États-Unis, et puis, là, j’ai entendu parler de la classe inversée par mes activités d’enseignement, et elle m’a intéressée pour deux raisons principales. La première, c’est que ça me paraît un moyen facilement transmissible de dépasser un enseignement transmissif. Et puis en outre, ça me paraît être un moyen prometteur pour lutter contre les inégalités et le décrochage scolaire. Et, comme vous le disiez, aux États-Unis, c’est vraiment quelque chose qui se répand à la vitesse de l’éclair. Louise Tourret : Donc, on reprend la définition de la classe inversée, c’est donc apprendre hors de la classe, et faire les exercices avec l’enseignant, ce qui permet de mettre tous les élèves en activité. Vous dites que c’est moins inégalitaire, Héloïse Dufour. Pourtant, le travail à la maison, on le sait, les devoirs, c’est très inégalitaire, car tous les enfants n’ont pas les mêmes possibilités de travailler chez eux : possibilités matérielles, la même aide aussi disponible de la part de leurs parents ou de leur entourage. Héloïse Dufour : Alors ce qui change dans la classe inversée, c’est la nature même du travail à la maison. C’est à dire que dans une... dans un enseignement traditionnel, ce qu’on va demander aux élèves à la maison, c’est de faire des exercices qui peuvent être problématiques, même s’ils ont l’aide de les, des parents, et on sait que même dans les familles plus ou moins en difficulté, il y a un investissement des parents important. Il peut y avoir problème de compréhension de l’énoncé par exemple, ou... alors que dans une classe inversée, l’idée c’est de faire un travail à la maison qui est uniquement de regarder des leçons par exemple, ou de vraiment préparer le cours. On demande... C’est un travail qui est simple, et qui ne demande pas de capacités spécifiques des parents, ou de... ou d’enseignants privés par exemple. Donc moi ce que j’ai fait, c’est que j’ai interviewé un certain nombre d’enseignants qui mettent en pratique la classe inversée, et il y en a un certain nombre qui, justement, se saisissent des nouvelles technologies, pour vérifier que le travail à la maison a été fait. C’est à dire que, en même temps qu’ils donnent des ressources à regarder ou à consulter, ils utilisent des questionnaires en ligne pour poser quelques questions très simples, vraiment de compréhension de base sur ce sur quoi portait la leçon, et ça leur permet, avant d’arriver en classe, d’une part de savoir si leurs élèves ont compris, d’autre part, s’ils ont effectivement fait le travail. Et pour les élèves, le fait de savoir que le prof sait, ça change les choses. Louise Tourret : Ah ben je trouve ça pratiquement terrifiant ! (Rires). C’est... ça fait partie des possibilités des nouvelles technologies, ça peut être aussi, oui, considéré comme une limite, parce que le contrôle devient, ma foi, très important. Il faut aussi s’intéresser aux limites de cette pédagogie. Ça demande quand même un investissement professoral différent, peut-être plus important, parce qu’il faut beaucoup s’impliquer, et puis il faut être très actif dans sa classe. Vincent Faillet. Vincent Faillet : Oui, absolument. A l’origine, Bergmann et Sams, qui ont véritablement fait découvrir la méthode, ont travaillé avec des capsules vidéo, donc ce qui suppose un enregistrement... Louise Tourret : Il faut les fabriquer. Vincent Faillet : Il faut les fabriquer. Héloïse Dufour : Pas forcément... Vincent Faillet : Il faut avoir les compétences, la technologie, pour les fabriquer, ou utiliser des capsules déjà existantes. Mais en règle générale, les enseignants aiment bien travailler avec leurs propres supports. Cela suppose de totalement repenser la classe évidemment, puisque le cours, le modèle transmissif classique doit être fait à la maison, donc il faut d’autres activités en classe, des activités qui vont supposer en effet des questionnaires à choix multiple, ou éventuellement l’utilisation de boîtiers de vote, des ateliers. Donc c’est un travail totalement différent pour l’enseignant, ça suppose un fort investissement, oui. Louise Tourret : Est-ce que on continue, avec cette classe inversée, à produire aussi des devoirs, des travaux un peu plus longs ? Là on parle de réponses à des Q.C.M, des petits exercices pour vérifier que la leçon a été comprise, mais il y a aussi une mobilisation de ces savoirs, traditionnellement dans la rédaction, la dissertation, dans des travaux un peu plus person- nels. J’ai l’impression que on sort un peu de ces exercices, ces pratiques du champ avec la classe inversée ? Vincent Faillet. Vincent Faillet : Non. On n’est pas obligé de changer la façon d’évaluer les élèves. Ce qui change vraiment, c’est la façon de favoriser l’accès à la connaissance. L’évaluation en elle-même n’a pas lieu forcément d’être changée. Héloïse Dufour : Et pour beaucoup d’enseignants que j’ai rencontrés, l’idée c’est pas d’augmenter la somme de travail à la maison, c’est juste vraiment d’en changer la nature. En termes de dissertation, de choses comme ça, moi j’ai rencontré des enseignants, en français par exemple, et qui utilisent la classe inversée pour faire produire aux élèves, en classe, des textes, et pour vraiment travailler avec eux, sur la production d’un texte, comment est-ce qu’on fait. Louise Tourret : Donc on intervient dans le travail personnel des élèves, c’est le faire avec l’élève... Héloïse Dufour : C’est passer du face à face au côte à côte. Louise Tourret : Vincent Faillet, ces pédagogies sont-elles séduisantes ? Et pourquoi le sont-elles ? Vincent Faillet : Alors... Louise Tourret : … auprès des enseignants. Vincent Faillet : Elles sont séduisantes parce que c’est une rupture avec un modèle qui est ancien, c’est le modèle transmis- sif. Depuis le Moyen Âge, on est dans un modèle transmissif, avec l’enseignant au centre, les élèves autour, il récite le cours, et une cohorte d’élèves prend le cours. Donc l’idée de la classe inversée, c’est de se positionner de façon très pragmatique où c’est l’élève qui est au centre de la réflexion, c’est l’élève qui va construire son savoir, avec l’aide de l’enseignant et avec l’aide de ses camarades également. Donc c’est séduisant parce qu’on remet l’élève au centre de la classe. Louise Tourret : Une idée qui ne séduit pas tout le monde pourtant, mais finalement, est-ce que la classe inversée, c’est abolir l’idée de transmission ? Héloïse Dufour. Héloïse Dufour : Alors je pense que c’est là qu’il faut préciser qu’il n’y a pas un type de classe inversée. Et je pense que c’est pour ça que la classe inversée marche aussi bien. On peut faire une classe inversée en restant dans le transmissif. On peut faire une classe inversée où on...c’est toujours l’enseignant qui donne les leçons à l’élève à apprendre, c’est toujours l’enseignant qui donne les exercices, et simplement qui se contente d’aider les élèves en classe. Moi je trouve que la classe inversée, c’est plus intéressant, justement, pour faire des tâches complexes, pour vraiment mettre l’élève en situation de production. Mais, encore une fois, pourquoi est-ce que ça séduit tant de gens ? Je pense que moi, tous les enseignants me l’ont dit, c’est vraiment cette idée d’interaction avec les élèves. Les enseignants qui sont en classe inversée, ils parlent à tous leurs élèves, tous les jours. Et là on revient sur pourquoi est-ce que c’est un moyen de lutter contre le décrochage scolaire par exemple ? Parce que ça renforce vraiment les interactions entre les enseignants et les élèves. Louise Tourret : Interactions entre les élèves, on en a un peu parlé, et j’aimerais beaucoup qu’on y revienne, c’est finalement favoriser quelque chose qui est assez laissé de côté, c’est les pédagogies coopératives dans l’école française, pédagogies qui sont peut-être plus adaptées au monde actuel, au monde professionnel aussi, quel que soit le type de métier d’ailleurs auquel on se destine. Vincent Faillet. Vincent Faillet : Disons que la coopération fait partie de l’arsenal pédagogique des élèves. Surtout avec les nouvelles technologies. Une fois rentrés chez eux, les élèves que j’ai pu étudier au lycée Dorian vont sur des plates-formes, alors pas forcément les plates-formes académiques type ENT, mais vont par exemple sur Facebook, ils coopèrent, ils s’échangent des informations sur les cours, sur les exercices. Donc la coopération... est un mode de travail tout à fait normal pour ces élèves. Un mode de travail dont ils sont habituellement privés dans un enseignement transmissif. Donc le fait de leur redonner la parole, de réactiver quelque part une dialectique moderne où l’élève va donner son point de vue, essayer d’expliquer à son camarade ce qu’il pense, séduit tout à fait les élèves actuels. Louise Tourret : Ce qu’on peut aussi dire, c’est que l’idée de la classe inversée répond à une problématique tout à fait contemporaine de l’école puisqu’on voit émerger tout un marché d’applications pour apprendre. Des applications qui per- mettent par exemple de réviser ses tables de multiplication, on peut tout à fait le faire avec une machine, ou les verbes irrégu- liers, l’orthographe, les conjugaisons, on peut dialoguer avec un ordinateur qui voit le type de fautes qu’on fait, qui conseille en termes de ressources : où est-ce qu’il faut aller chercher ? Quelle leçon il faut consulter ? On recentre donc la mission enseignante sur l’humain, si je vous suis bien. C’est ça Héloïse Dufour ? Héloïse Dufour : Oui. Et je pense que... Là, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que les nouvelles technologies ne sont vraiment pas le point principal de la classe inversée, c’est un facilitateur, mais l’idée c’est vraiment de changer ce qui se passe en classe, d’avoir un enseignant qui est là pour faire apprendre les élèves, leur... éventuellement même leur apprendre à apprendre, et...voilà. Louise Tourret : L’enseignant fait quelque chose que la machine ne pourrait pas faire. Il peut voir si l’élève a compris euh, l’évaluer. Il y a toujours un petit peu de psychologie, il y a toujours une dimension psychologique dans le fait d’enseigner. Vincent Faillet, qu’est-ce que vous pensez de cette idée ? Vincent Faillet : Oui, c’est... on est loin de la machine à enseigner, on est vraiment, comme vous le souligniez, dans l’humain, et on redonne la parole à l’élève, et...la.. certes les technologies ne sont pas forcément, nécessairement présentes. On peut faire de la classe inversée sans technologies, mais on peut également le...la faire avec des technologies, et là je pense aux travaux d’Éric Masure, où il va travailler avec des boîtiers de vote, ce qui va permettre à des élèves qui habituellement ne s’exprimeraient pas - parce que là c’est un problème, l’expression - de pouvoir donner leur avis, de pouvoir répondre, de pouvoir participer à la classe. Donc on modifie complètement la psychologie de l’élève au sein même du groupe classe. Et des fois on a des surprises, on peut constater, je l’ai constaté moi-même, que des élèves qui pouvaient avoir l’air totalement effacés en fond de classe, eh bien, prenaient goût à la parole, et prenaient goût à la dialectique de façon à s’exprimer et à faire valoir leurs idées. Donc c’est très intéressant d’un point de vue psychologique. Louise Tourret : Vincent Faillet, sur, finalement, ces pédagogies qui peuvent se répandre sans contrôle institutionnel, sans cohérence aussi entre les enseignants ? Vincent Faillet : On est dans le bricolage, mais dans le bricolage dans l’esprit de Levi-Strauss, c’est à dire l’esprit noble du bricolage. L’enseignant, l’artisan, dans sa classe, avec ses moyens, avec sa vision, avec ses élèves, dans un univers assez clos, qui va mettre au point sa classe inversée. La classe inversée de Saint-Brieuc n’est sans doute pas celle de Paris...euh... Ce qui est intéressant, c’est que ce bricolage – c’est un bricolage évolutif – c’est François Jacob qui disait que l’évolution, c’est un bricolage moléculaire où l’on fait du neuf avec du vieux. Eh bien je pense qu’on est tout à fait dans ce cadre-là, et l’intérêt, c’est ce que c’est un bricolage qui vient de la base. Ce sont les enseignants qui s’approprient de nouvelles méthodes d’enseignement, et c’est assez nouveau en France. Et c’est peut-être le gage d’un, du succès. C’est à dire, ce n’est pas une volonté hiérarchique qui viendrait des ministères ou de l’Académie, ce sont les enseignants qui, il suffit de regarder divers blo- gues sur internet d’enseignants qui se posent des questions au primaire, secondaire, collège, lycée... où on se rend compte eh bien que l’on essaye de faire ce que l’on peut avec une emprise très proche des élèves. Donc on est dans du bricolage qui vient de la base, qui se répand, donc je pense que c’est quelque chose qui devrait être regardé avec grande attention de la part des instances académiques et ministérielles. Louise Tourret : Eh bien ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Vincent Faillet, je rappelle que vous menez des recherches en sciences de l’éducation sur la classe inversée. Merci Héloïse Dufour, biologiste, vous avez fondé le site, l’association Inversons la classe. Bonne après-midi sur France culture ! (pause de 3 minutes) Vous avez maintenant une heure pour préparer le compte rendu et la présentation personnelle. Seconde écoute [Arrêt de l’appareil de lecture] |